
Le lac des cygnes
Rudolf Noureev
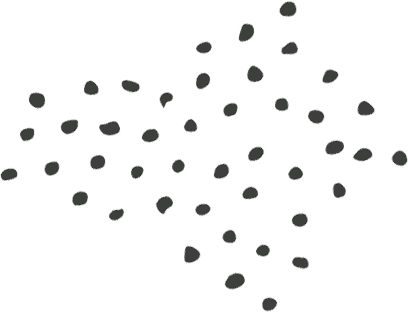
D’ombre et de lumière
Pour la 304ème représentation du Lac de Noureev à l’Opéra National de Paris, j’avais le désir de revoir l’opus à Bastille avec une distribution qui, quoique n’étant pas à proprement parler le fait de deux prises de rôles, mettait en lumière deux Premiers Danseurs à l’avenir prometteur au sein du Ballet, Héloïse Bourdon et Pablo Legasa. Et, bien sûr, le plaisir toujours enivrant de retrouver Thomas Docquir en Wolfgang/Rothbart, ce Sujet aguerri au rôle, lui qui l’incarne avec tant de prestance…
Je fus tout sauf déçue. D’entrée de jeu, Pablo Legasa en Siegfried, même encore assis sur sa chaise princière, convainc qu’il s’est incorporé le personnage ambivalent du Prince. Et cela, parce que son physique, pétri de candeur mêlée à un caractère viril, nous emmène vers la lumière des émotions des premières amours. Si son abattage technique, par la suite et de façon filante dans tout le ballet, nous éblouit, ce qui me touche à titre intime est son profond sens théâtral. Car sa physionomie traduit si bien l’enthousiasme sentimental que nous ne pouvons que le suivre émotionnellement, respectivement dans son élan, la découverte de l’Eros, son assurance naissante, son illusion et, enfin, son repentir. C’est pourquoi il porte le Lac grâce à une interprétation dont son placement, ses tours cambrés, sa saltatoire, toujours extrêmement romantiques sans jamais sombrer dans le maniérisme, fait de lui un soliste complet, mais aussi et peut-être surtout par l’expression bouleversante de son visage…
Quant à Héloïse Bourdon, dès qu’elle entre en scène, je suis trop tentée par mon éblouissement de ses lignes pour ne pas citer Flaubert relatant la rencontre qui se joue dans le fantasme de Frédéric Moreau découvrant Madame Arnoux à l’Incipit de L’éducation sentimentale : « Ce fut comme une apparition. » Notre princesse transformée en cygne par le sort prouve par la suite, au fil des IV Actes, que le rôle lui sied par maints aspects. A commencer par sa puissance d’actrice : sa chair dansante bien sûr – le moelleux de ses bras, la délicatesse de ses doigts, ses dégagés, sans parler des 32 fouettés véloces d’Odile – mais que dire de son expression quant à l’ambiguïté du personnage onirique ?… Héloïse Bourdon est en effet apte à traduire autant la fragilité apeurée, sans la moindre trace d’hystérie, la sensibilité blessée d’Odette, que la force de séduction perverse d’Odile, en laquelle elle emmène tous les spectateurs jusqu’à l’oubli provisoire d’Odette, dont la mémoire pure est trahie par le prince lui-même. Si Nietzsche a eu raison de décrire dans sa correspondance avec Malwida concernant Lou Salomé la femme telle « un chat, qui se joue de nous par son charme batailleur », en voyant Héloïse Bourdon, on songe également à la formule du philosophe évoquant le sexe dit faible comme « le cache-cache de la nature souillée ». Car elle nous fait si bien oublier les motifs naturels de l’ « humain, trop humain », en nous embarquant dans un univers où le surnaturel se fait réel, plus réel même que la nature… Là ne réside-t-il pas l’essence d’une grande artiste ?
Or, je dois avouer que les mots me manquent pour définir l’admiration que je porte à Thomas Docquir. Car de ses manèges, en ses envols tout comme en leur réception, son pouvoir de fascination maléfique a fortiori, il incarne pour moi viscéralement l’un des meilleurs Wolfgang/Rothbart qui soit. Figure de l’ombre, il est pourtant lumière, par l’œuvre au noir impeccablement menée de son jeu tant technique, de propreté irréprochable, autant que par son charisme digne d’une Etoile, puisque nous faisant chavirer vers l’abîme de la tentation. Le péril du rôle consiste à ne pas sombrer dans l’écueil de la grandiloquence. Thomas Docquir parvient non seulement à échapper à cette dérive, mais il y a plus : il devient, en quelque sorte, le rôle principal du Lac, parce qu’il donne à voir « mal en personne », pour plagier Jean-Luc Marion en ses Prolégomènes à la Charité. Et le péché n’est-il pas la tentation et, éminemment, le sujet, précisément, du Lac ?
Avant d’achever ces quelques mots qui ne sont que des paroles incitant à voir ou revoir la version de Noureev, j’aurai un mot sur la tenue du Corps de Ballet, avec une émotion particulière à l’endroit d’Aubane Philbert, dont la délicatesse lors notamment du Pas de Trois de l’Acte I me transporte toujours ; sans parler de son placement, de ses lignes, de sa présence littéralement réjouissante…
C’est pourquoi, grâce à tous ces éléments gracieux au sens étymologique, je suis passée de l’ombre à la lumière, selon le mode opératoire tourbillonnant de la transmutation des valeurs mise au jour par Nietzsche. Et cela ne peut être que, in fine, une confrontation amoureuse de sa rencontre, quoique conflictuelle, avec le mystère de la foi. Car cette distribution du 26 décembre, au lendemain même de la Nativité, me fait vous renvoyer aux premières paroles de la Genèse : « il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, mais l’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Autrement dit, de l’ombre à la lumière, il n’y a qu’un pas – celui d’une grande maison, l’Opéra National de Paris, qui sait quels rôles reviennent à qui de droit.
Bérengère Alfort


