les hivernales
espèces d'espaces-danse
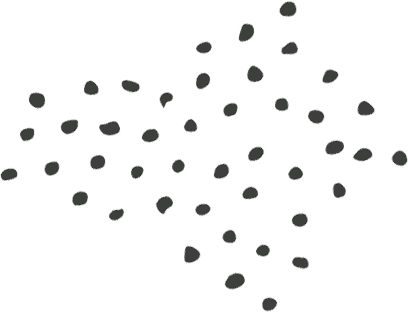
une journée aux Hivernales
Il aura suffit de deux mots et d’une programmation stimulante dans la même journée pour déclencher le désir de sauter dans un bus matinal depuis Marseille. La balade anthropocène collective proposée par le chorégraphe Frank Micheletti et le géographe Michel Lussault à la 44e édition des Hivernales d’Avignon, le 11 février 2022, précédait le duo Alchimie de Romain Bertet et Marie-Laure Caradec, puis le solo magistral SOMNOLE de Boris Charmatz. Finalement, c’est une traversée des trois échelles principales de nos rapports au monde à laquelle nous allons assister : assemblée, relation au groupe, aux espaces paysagers qui nous entourent pour la première proposition ; altérité, relation à l’autre, à la scène et la scénographie pour la deuxième ; et enfin introspection, relation à soi, au vide et au public, miroir des projections scéniques.
Retrouver Avignon, c’est voir surgir le mot théâtre à chaque détour de rue bien sûr, associer ses pas dans un lieu à des souvenirs de festivals passés, se faire attraper par l’heure fraîche pour chercher le soleil au sommet du Jardin du rocher des Doms, englober le territoire alentour, tomber sur l’exposition photographique en plein air Côté Jardin et croiser en liberté les grandes figures de la troupe du Théâtre National Populaire de Jean Vilar. Mais aussi découvrir le Musée du Petit Palais des archevêques (XIVe s.) et ses chefs d’oeuvre du début de la Renaissance (dont Botticelli), traverser le parvis du Palais des Papes en compagnie d’un plastique emporté par le mistral, faire un crochet par la librairie d’art de la Collection Lambert, déjeuner sur les bancs du square Agricol Perdiguier derrière l’Office de Tourisme et finir Porte de l’Oulle… pour mieux commencer ! Toutes ces errances-bifurcations dans la ville ravivent la flamme pour cette fascinante unité urbaine issue de l’histoire papale, comme son aura de cité-festival qui a marqué mes élans de gamin vers le spectacle, mais la balade anthropocène va justement rebattre les cartes de ces visions trop communes.
Espèces d’espaces ! Le livre (1974) de Georges Perec brandi par Lussault comme l’invité surprise de cette marche ludique et didactique organisée avec Micheletti n’est pas pour nous déplaire. Il servira de fil conducteur pour goûter aux espaces en général, aux mots et aux sons en particulier, sortir des remparts pour mieux les envisager, ou les oublier depuis les berges de l’Ile de la Barthelasse, frissonner avec le flux du Rhône, dénombrer ce qui bouge, être bougé par nos perceptions et se fier à d’autres sens, plus internes pour comprendre comment l’espace nous meut et nous émeut. Vivre, c’est passer d’un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner, résume Perec. En embarquant un groupe d’une cinquantaine de personnes pour quelques stations emblématiques d’une boucle en territoire Bagatelle, le duo complice veut justement nous faire prendre conscience de ces Micro collisions qui parsèment nos existences. Sur le pont bruyant, sous le platane majestueux, le long de l’ancien fleuve à tresses, au ras du sol, herbe ou bitume, allongé comme le chien, au contact du sable gris qui passe comme un tamis entre les doigts de la main, proche du groupe, loin du pont St Benezet, dans les traces du chemin étroit, sur la terrasse en planches de la guinguette, en belvédère devant les champs cultivés… aucun lieu n’est insignifiant. Les perspectives et les rêveries changent, et non seulement marcher peut devenir comme Nietzsche le prophétisait une itinérance spatiale de la pensée, mais chaque expérience liée à l’incroyable variété des espaces peut provoquer des types de mouvements singuliers. Et se complexifier dans des formes dansées concrétisant toute la disponibilité sensorielle dans l’appropriation de ces espaces.
Selon Perec, l’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ? Oui, ça a eu lieu ! Cet attroupement a bien eu un lieu, en cercle compact autour de Frank Micheletti jouant d’un ingénieux juke box anthropocène mixant vieux disques colorés et vinyles 45 tours, collision de microsillons, oscillant entre chants d’oiseaux, voix off sur les gaz de schistes, grésillements et rengaine sudiste de Nino Ferrer. Cette capacité du son à faire espace, spectacle, sensations, sens, situation, décrite par le philosophe et musicologue Peter Szendy, marquera le point d’orgue de la balade.
Aboutissant au Théâtre Golovine, le duo qui a plus d’un pas de côté en projets, échange encore généreusement avec les quelques mordus de l’expérience au grand air. Le scientifique rappelle la crise de l’habitabilité de notre planète, le seuil critique de nos sociétés thermo-industrielles et les sécheresses inquiétantes pour un mois de février. Ils théorisent leur relation au diapason, M. Lussault avouant prendre facilement « le plateau (la scène) comme une paillasse » et l’artiste se glissant dans son discours improvise quelques gestes, jeux de réglage des placements, des intervalles, et des possibles par le lien que génère la danse… ce que les mots ne disent, ce qui échappe, ce qui reste ouvert de l’expérience spatiale.
Le duo Alchimie aura la même force de contact et de complicité mais peut-être avec moins de jeu, moins d’éclat et de combustion annoncée en tout cas. Accueillie aux Hivernales – CDCN d’Avignon, la proposition de Romain Bertet, chorégraphe de la Compagnie l’oeil ivre, laisse un peu sur sa faim justement à cause de l’intensité des mots contenue dans son pitch qui annonce « une plongée physique dans l’imaginaire de l’incandescence et de la fusion, des élans qui nous brûlent et des passions qui nous embrasent ». Malgré la puissance de leur engagement physique, leur maîtrise indéniable du rythme et des enchaînements en contact, le danseur et la danseuse épuisent assez vite l’impact de leur ardeur, aussi intense soit-elle, leurs déplacements exigeant une précision vis à vis du dispositif de bougies suspendues, qui ne doivent bien sûr pas enflammer le théâtre. Iels deviennent flammes, certes, jouant pleinement des saccades du mouvement des corps, et des apparitions-disparitions que permet le noir sous les porte-bougies, mais dans la métaphore du feu et du désir, on pressent les torches et la torture, reflétées par leur première entrée frontale énergique qui nous prend à témoin avant leur face à face. Dans une scénographie où luisent une quinzaine de cylindres verticaux dispersés sur tous les niveaux de la scène, une mécanique invisible laisse apparaître et dissimule tour à tour les bougies allumées qu’ils contiennent. Nous sommes alors ramenés au temps des éclairages à la chandelle qui rend l’espace velouté et plus ou moins obscur, tel un tableau de Georges de La Tour.
Par contraste surprenant, l’air du froid du King Arthur de Purcell rappelle que dans cet hymne allégorique du semi-opéra baroque, le Génie du Froid est mis en péril par le pouvoir de l’amour pour décongeler les coeurs. La bande son signée Eric Petit exhorte également le duo par ses tensions, à réitérer les assauts contradictoires de la communion des corps, qui marque le principe ambigu et changeant du feu analysé par Gaston Bachelard. L’effet d’embrasement jaillira du lointain sur un sol scintillant à l’infini, jusqu’à sa disparition dans un halo persistant et véritablement alchimique sous les cintres.
Pour SOMNOLE, Boris Charmatz choisit de se chorégraphier en solo. La gageure est grande, l’espace de la FabricA du Festival d’Avignon est immense et dans ce vide, seul le tapis de danse légèrement argenté renvoie la lumière d’une rampe en avant scène et d’une unique poursuite mobile sur son axe qui descend du gril. L’espace est un doute avance Georges Perec, il faut en faire sans cesse la conquête. Dans cette pièce, nous baignons autant dans l’espace que l’être qui le fend depuis le côté de la salle, bras tendus en l’air comme un somnambule, suspendu entre terre et ciel, écartelé comme un abstrait chromosome. C’est la force de ce « solo somnolant » qui nous emmène dans les dédales du rêvassement de son auteur et nous fait accepter le nôtre par empathie. A l’écoute profonde de son geste en devenir et de sa ligne mélodique propre, jusque dans ses retranchements, il est vraiment seul mais aussi avec nous. Ou plutôt nous sommes dans sa nuit, accrochés par ses rêves et les multiples nous présents dans son je.
L’espace est parfaitement maîtrisé et en même temps totalement malaxé, joué dans ses cadres et ses évidences, traversé par une conscience folle et une liberté qui avance à tâtons. La porte latérale martelée s’ouvrira en fait lors des saluts, la ligne d’horizon au lointain est quasiment embrassée, le tour de piste n’est pas éludé, le sol, grand partenaire du danseur devient le support d’un dialogue permanent, la tête à l’envers n’empêche pas de se gratter les jambes, et le franchissement du quatrième mur du public pour une invitation de danse esquissée va jusqu’à une injonction doigt pointé à l’accompagner à siffler.
Car le défit supplémentaire et l’idée tenace que se donne Charmatz pendant toute la pièce est de faire passer le souffle en chuintements, sifflements, sifflotements, selon ses degrés de somnolence, d’épuisement et de lucidité mélodique. Encore une fois l’espace est habillé totalement par la magie du son. Avec son corps puissant, la peau blanche de son torse nu et une jupe à multiples pans verticaux matiérés et imprimés qui nous emmène dans un imaginaire exotique malgré ses tons tricolores, Charmatz se joue de la présence, si chère au travail scénique en revendiquant son absence, son retrait derrière les variations d’un son et apparaît magnifique. Est-on plus proche du ciel que de la terre quand on dort ? Le danseur est suspendu entre les deux et la pleine lune du projecteur qui se dessine dans le noir lorsqu’il sort lentement par où il est arrivé, nous regarde alors interrogativement. Il est temps de p(ro)longer dans la nuit ce qu’a agité la journée.
Gilles Viandier



