
Du principe de la muse
Julie Guibert, danseuse
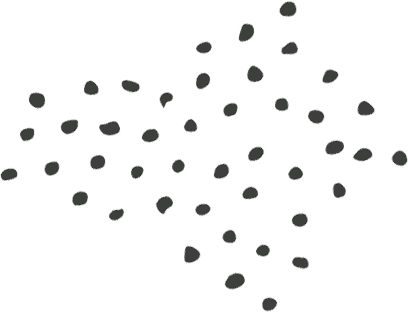
Du corps de l'interprète.
Elle a dansé au sein du Ballet du Nord (avec Maryse Delente), du ballet Cullberg (avec Mats Ek) et du ballet de l’Opéra de Lyon, où elle rencontre Christian Rizzo, qui crée pour elle le solo b.c., janvier 1545, fontainebleau (2007). La même année, elle confie à Stijn Celis de lui écrire un solo, commandé par la SACD : ce sera Devant l’arrière-pays. Quatre ans plus tard, Herman Diéphuis lui écrit Exécutions. Et en 2014, Mélanie Perrier crée pour elle le solo Nos charmes n’auront pas suffi. Quatre chorégraphes se sont donc inspirés de sa danse pour écrire : entretien avec Julie Guibert, danseuse émérite.
Par Charles A. Catherine
Comment se met-on entre les mains d’un.e chorégraphe ?
La manière de s’y retrouver, de se mettre « entre les mains de », dépend de la manière dont nous nous avançons jusque là, de l’histoire qui précède ce moment de l’écriture, ce face à face avec le chorégraphe, qui est davantage en fait un face à face de nous deux avec la pièce à venir. Chaque histoire est une histoire, il n’y a pas de technique particulière, juste le désir d’une rencontre à deux. Un jour, une invitation est formulée, de l’un ou de l’autre à l’autre, et simultanément la promesse d’un travail, qui est le véritable objet du désir.
Nous nous mettons alors entre les mains du travail ; car c’est la pièce à venir qui nous dirige, avec cette sensation un peu mystérieuse. C’est un espace-temps tumultueux, toujours tellement difficile, puissant et heureux, aussi. Dans ces périodes de travail, je me sens toujours pleinement présente, entièrement convoquée, moi et tous ceux dont les gestes, les paroles, les regards m’habitent, dont celui du ou de la chorégraphe qui nourrit et augmente cette présence qui augure la pièce à venir.
L’interprète que je suis est tout autre que celle que je suis, mon corps devenant le lieu plein d’une écriture qu’est la pièce. Je m’inspire du chorégraphe davantage que celui-ci s’inspirerait de l’interprète que je suis pour écrire : il est le regard qui me fait devenir le texte que nous poursuivons ensemble. Je vois dans cette éclosion, et y cherche, le sens d’une tragédie : elle se passe à cet endroit de disparition absolue de moi. Simultanément, ce moment je le ressens comme celui de la création de mon propre paysage, de ma propre géographie. Après chacune de ces collaborations, je me suis retrouvée transformée, comme augmentée dans la profondeur, aiguisée peut-être, affutée. Jamais indemne.
Quelles sont les règles et limites de ce travail particulier ?
Il y a toujours une certaine admiration réciproque, une reconnaissance, une confiance, un attachement qui font que l’invitation se formule, qui font que le travail a lieu. Cette confiance est le sol sur lequel s’appuie l’écriture. Alors le travail est un état, c’est une respiration commune, c’est disons une manière de conspirer, de respirer ensemble. Dans le travail alors, on s’avance côte à côte, on avance dans un état second, à l’instinct. Rien n’est pour autant fluide et mécanique ou naturel : nous nous ajustons, et parfois nous savons en désaccord. Sans le dire, ça se sait.
Je veille à ne pas me retrouver à des endroits où je pense que ça n’est pas juste, où ça ne me semble pas résonner comme il le faudrait. Je ne sais m’astreindre à cela, je ne sais subir un tel inconfort. Il m’est bien sûr arrivé de traverser des moments difficiles, de m’avancer dans des séquences que je n’aimais pas. Si je m’y suis pourtant aventurée c’est que je savais que nous allions vers quelque chose d’autre, de précis, de nécessaire. Les passages sont douloureux ou désagréables parfois, mais ils se franchissent parce que l’on connaît le chorégraphe, parce que cette confiance qui fait le sol reste de mise, parce que nous venons ensemble de loin, d’une histoire. Alors on dépasse ensemble ce qui ne s’avère être qu’une aridité passagère.


