
Les petites filles modernes (titre provisoire)
Joël Pommerat
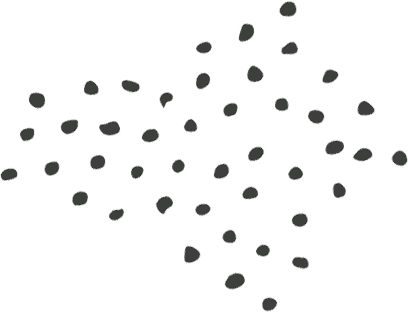
Pommerat sous cloche : conte glacé, frissons garantis
Pommerat, c’est un peu le Castellucci des Français. Il a beaucoup d’argent pour faire ses spectacles, du temps et des moyens, et forcément on se dit que ça devrait produire du grand théâtre. Et quand il n’en avait pas, du temps et des moyens, eh bien il était déjà là, capable du meilleur. C’est ça aussi qui impressionne : cette continuité, cette obstination à fabriquer un monde.
Avec des gimmicks qu’on lui reconnaît, qui font sa signature : les bruits de pas venant des coulisses, cet art du hors-champ au théâtre, extrêmement malin, qui fait sentir que la scène est plus grande que ce qu’on voit, qu’il se passe toujours autre chose, ailleurs, à côté, derrière. Des voix amplifiées qui nous font entendre le chuchotement, non pas comme un trucage mais comme une proximité fabriquée. Surtout un art de la boîte noire : des ombres longues, des visages qui apparaissent puis se retirent, des corps qui semblent sortis de la nuit. Et tout cela avec une économie de gestes, presque sèche : ça bouge peu, ça vient se placer, ça dit son texte, frontal. Et ça permet d’entendre les mots.
Car Pommerat n’est pas seulement un metteur en scène, c’est un auteur. Un auteur avec une langue, une langue qui sait être simple et tranchante, familière et inquiétante. Et depuis quelque temps, ce qui semble l’intéresser, plutôt que la politique au sens direct, c’est le conte. Pas le conte sucré. Le conte comme machine à violence douce. Le conte comme laboratoire moral. Et voilà Les petites filles modernes (titre provisoire), conte pour les fêtes de fin d’année, donc pour la famille, donc pour l’enfance, donc pour le refoulé. Et on retrouve tous les éléments signatures. Si vous avez déjà vu un Pommerat, vous n’êtes pas perdu.
Bon, c’est toujours un peu étrange, ça : qu’on demande aux maîtres de refaire ce qu’ils savent faire très bien, comme si la reconnaissance était une commande de répétition. Alors que ça devrait être à eux de produire du neuf, pas à l’artiste émergent qui n’a pas encore l’expérience. Mais c’est un autre débat. Donc nous voilà en terrain connu. Avec le hors-champ, les micros, le conte. Tout est millimétré, propre. Trop propre parfois. Au point d’être terriblement froid. Angoissant même : une enfance sous verre, une modernité en forme de piège, des figures qui ressemblent à des apparitions plus qu’à des personnages.
On pense à Beckett pour cet univers hors temps, à Lynch pour l’absurde qui touche à l’horreur, à Ikeda pour une certaine puissance des images et des pulsations visuelles, pour cette maîtrise qui hypnotise. Pommerat semble viser l’horizon des événements, comme dans Interstellar, et y arrive presque. C’est vraiment un spectacle d’une grande prouesse. Un spectacle un peu WOW. Mais c’est peut-être ça le souci : trop de maîtrise. Où est la scorie, le grumeau, l’erreur et le vivant ? Il faut aller voir ce spectacle, surtout si on n’a jamais vu un Pommerat. Avec le risque, malgré l’admiration, de rester un peu sur sa faim, tenu à distance.


