
Outrar
Volmir Cordeiro
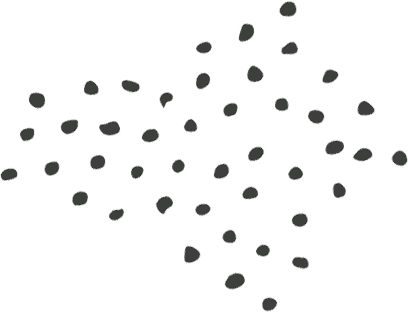
émeute d'un corps muet
Il entre comme on dérange. Il entre comme on mendie. Un corps fauché, fardé, affamé de présence, chargé de mille étoffes comme d’autant d’exils silencieux. Volmir Cordeiro traverse le plateau tel un orage de matière et d’âme, porteur d’un message dont on ignore s’il vient de lui ou de nous. Il ne danse pas pour séduire : il danse pour survivre, pour conjurer l’immobilité qui gangrène l’air même que nous respirons. Il érige son propre carnaval, un carnaval de ruines et de résurrections, né d’une époque claustrée, d’un monde confiné. Dans Outrar, fruit d’une solitude pandémique, chaque mouvement est une réponse au silence, chaque geste une question posée au monde figé qui l’entoure.
Car Outrar est né de l’isolement. Travail du confinement, il porte en ses fibres la mémoire d’un temps suspendu où les corps, partout, furent interdits de se frôler, de s’enlacer, de s’infecter de vie. Cette pièce est une tentative désespérée et joyeuse d’outrepasser cette frontière invisible, cet interdit de la rencontre. Dans cette danse surgit l’idée de contamination : mais qui contamine l’autre ? Est-ce lui, le performeur incandescent, terriblement vivant, en perpétuelle mue ou nous, spectateurs comme déjà morts, fossilisés dans nos fauteuils, rendus malades par notre propre retenue, nos peurs ? Il semble danser pour réveiller les morts.
Oui, Volmir Cordeiro nous fait face comme un vivant parmi les morts. Il explose, il s’effondre, il déborde. Chaque mouvement est un séisme minuscule, une révolte contre la paralysie générale. Le public, quant à lui, semble frappé d’une étrange léthargie, réduit à une masse inerte face à l’émeute de gestes, de couleurs, de cris muets que déploie le danseur. Ce déséquilibre est peut-être le véritable sujet de Outrar : la danse ne vient pas flatter le regard ; elle vient le heurter, le déstabiliser, le forcer à se souvenir de ce que c’est que d’être, simplement, vivant.
Recouvert d’une accumulation de jupes, de tissus chatoyants, de parures improvisées, Volmir Cordeiro évoque une drag queen surgie des favelas, loin des dorures et des paillettes normées. Ici, le travestissement n’est pas un artifice, mais une nécessité. À chaque geste, il se défait d’une couche, il dévoile sans jamais livrer. Sous chaque masque, un autre masque. Sous chaque masque, un soupir, une résistance. Ce n’est pas un strip-tease au sens trivial du terme ; c’est un effeuillage sensible, presque douloureux, un dévoilement sans fin qui témoigne d’une infinie fragilité. Chez Volmir Cordeiro, le glamour est politique et le travestissement une prière.
Le performeur vient en quête d’un lien, mais il rencontre l’absence, l’inertie, le mur d’un silence assourdissant. Cette mendicité du regard, cette quête inassouvie, résonne avec d’autres pandémies, d’autres exclusions, d’autres corps mis à l’écart, tenus à distance, désignés comme porteurs d’un danger innommable. Dans ce théâtre de la contagion toujours possible, la mise à nu n’est pas seulement corporelle : elle est existentielle.
Et pourtant, malgré le rejet, malgré l’indifférence simulée ou réelle de ceux qui le fixent sans savoir comment répondre, Volmir Cordeiro continue d’habiter l’espace. Il fait de chaque pas une tentative de rencontre, de chaque chute une main tendue. Outrar devient alors une ode magnifique et tragique à la vulnérabilité humaine. Le danseur, par sa furieuse douceur, nous rappelle que nous sommes des créatures d’échange, de frottement, de caresses.
À travers cette danse fougueuse et écorchée, Volmir Cordeiro ne propose pas une solution, mais une blessure ouverte, une invitation à repenser ce que signifie toucher l’autre. Dans le fracas de ses gestes, dans l’éclat ravaudé de ses costumes, c’est toute l’urgence de vivre qui explose sous nos yeux assoupis.
Outrar ne se regarde pas. Il se reçoit comme un souffle nécessaire, une secousse intime, un cri dans la nuit confinée de nos âmes. Ici, c’est la danse qui réclame l’embrassade. Et même si nul ne répond, Outrar reste un appel. Un appel venu d’ailleurs. Ou peut-être de très près. De cet endroit en nous qui se souvient qu’être vivant, c’est aussi être vulnérable. Et vouloir, malgré tout, toucher l’autre. Par la danse
Thomas Adam-Garnung


