
Nexus de l'adoration
Joris Lacoste
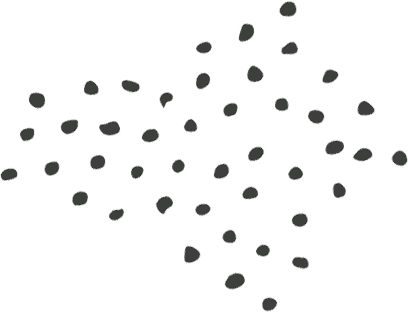
messe pour tout ce qui existe et le reste
Il s’agit d’une cérémonie. D’une célébration. D’une messe, disons-le sans détour. Une messe qui entreprend de chanter les choses du monde, toutes les choses du monde, celles qu’on chérit comme celles qu’on abhorre, celles qui nous traversent, nous encombrent, nous enchantent ou nous abîment. Un chant liturgique qui pourrait se poursuivre jusqu’à la fin des temps, au-delà même du spectacle, dans cette logique de continuation infinie qui rappelle L’Île du salut de Mathias Langhoff : un spectacle sans fin pour une matière sans bord.
C’est donc moins une pièce qu’un concert auquel nous sommes conviés. Un concert étiré, ralenti, délicieusement suspendu, comme s’il obéissait à un commandement de John Cage : « si tu peux le faire en deux minutes, fais-le en quatre ». Une comédie musicale hippie chic new age queer qui glisse tranquillement vers le cours de fitness doux, le rituel communautaire ou la prière profane. Une chorale de fées radicales (oui, fées, parce que leur puissance tient moins à leur voix qu’à cette façon de faire apparaître le monde en chantant) qui juxtaposent, sans hiérarchie apparente, les éléments de l’étant passé, présent et à venir. Rien n’est oublié. Tout est accueilli. Et le public n’est jamais loin de chanter avec elles ; il ne manque réellement que les textes sur les prie-Dieu pour qu’on puisse suivre les litanies comme on suit un chant grégorien.
C’est impitoyablement drôle. C’est d’une intelligence rare. Et surtout, c’est remarquablement composé. Car tout est écrit, millimétré, même quand cela donne l’impression de se déployer avec la légèreté d’une improvisation cosmique. Le spectacle repose sur un double plan : celui de la fiction : célébrer le tout-venant dans une joie sans cynisme, et celui de sa propre mise en scène, qui organise avec une mauvaise foi réjouissante ce qui sera célébré et dans quel ordre. Mis côte à côte, les insignifiants se mettent à parler, à produire du sens, à tisser du lien. Le monde devient une constellation où les choses se répondent malgré elles. C’est souvent absurde, évidemment, comme nos existences.
Il y a du Deleuze dans cette façon de tout lier, sans centre, sans origine, sans hiérarchie. Le rhizome, forcément, cette figure qui permet de penser la prolifération, l’interconnexion, l’horizontalité. Mais il y a aussi du Jankélévitch et son je-ne-sais-quoi et le presque rien. Du Plotin, mais sans l’Un, comme si Lacoste avait gardé la procession et oublié la totalité. Du Heidegger également, un Dasein qui affleure dans cette manière de faire advenir le monde par l’énumération. On oscille constamment entre pop culture et érudition, doom scrolling et métaphysique. Ce flottement est le cœur du spectacle : une pensée qui refuse de choisir son camp.
Joris Lacoste, lui, agit comme un hypnotiseur. Pas un hypnotiseur de foire, mais un hypnotiseur métaphysique. Il manipule, suggère, déplace, avec la malice d’un enfant et la précision d’un chirurgien. Dans Le Vrai Spectacle, il avait déjà créé les conditions d’un théâtre intérieur où chaque spectateur rêvait sa propre pièce. Ici, litanies et lenteur produisent une douceur presque narcotique, une certaine léthargie, un état de flottement propice à la rêverie. Le spectateur ne suit plus le spectacle : il y glisse.
Ce désir d’exhaustivité n’est pas nouveau chez lui. On le retrouve dans Encyclopédie de la parole, entreprise monumentale visant à collecter toutes les manières de parler. Pour Nexus de l’adoration, Lacoste invente le « néférisme », une catégorie nouvelle, « rite et célébration », qui le rapproche d’un théâtre rituel, peut-être artaudien, peut-être post-artaudien : un rituel débarrassé de ses transcendances, une célébration athée mais vibrante, une spiritualité pour temps matérialistes. Classer une telle forme est une contradiction assumée : la suite pérecquienne s’accommode mal des catégories, et c’est tant mieux.
Le spectacle, malgré la virtuosité de sa construction, reste d’une grande douceur. Une méditation guidée, oscillant entre tragique et farce sans jamais verser dans l’un ou l’autre. On y cherche malgré soi ce qui tiendrait lieu d’homélie, ce qui évoquerait la paix du Christ, ce qui dans ce rituel profane fait signe vers le sacré. Même la société de consommation y apparaît comme un rituel à part entière, un fétichisme de la marchandise qu’un marxiste pur et dur, car Lacoste en est un, pointe avec une habileté tranquille, presque invisible.
On pourrait croire que la juxtaposition de tout ce qui existe mène au relativisme. C’est l’inverse. Tout est organisé. Le plateau affiche des identités queer. La recette du cocktail Molotov, la kétamine et la white widow côtoient deux évocations de Spinoza et, en creux, le rhizome deleuzien (on l’a dit), le panopticon foucaldien. On est clairement chez les wokistes et c’est tant mieux. Lacoste permet aux choses que l’on désire et à celles qu’on voudrait éviter de s’entrechoquer, poussant l’intersectionnalité à son point de combustion. Produisant ici un espoir incandescent dans un monde si sombre.
Et puis il y a les formes. Une suite de choses devenue suite de formes : cours de fitness aérobic, sermon d’une intelligence artificielle, coaching de développement personnel, concert electro à la Laurie Anderson (vocodeur en majesté), stand-up, chorégraphies qui convoquent tour à tour Pina Bausch et Anne Teresa de Keersmaeker (Rosas danst rosas est bien cité). Une liste à la Pérec, et, plus profondément encore, une mise en œuvre de la méthode W, cette boîte à outils indispensable pour penser le spectacle vivant. Rien n’est laissé au hasard. Et au moment même où le spectacle pourrait sembler distant, presque froid, surgit l’évocation du décès de la mère de l’une des interprètes, instant de grâce intime immédiatement suivi d’une farce de Thomas Gonzalez, comme pour rappeler que le pathos n’est pas leur langue.
Dans 1984, Orwell décrivait la novlangue comme une arme pour empêcher la révolte : si on supprime le mot, on supprime l’idée. Ici, tout se passe comme si Lacoste nous rendait notre pouvoir en nommant les choses. Toutes les choses. Il y a là un geste politique profond, un véritable empowerment : redonner aux mots leur pouvoir d’agir.
Nexus de l’Adoration est une forme poétique, jouissive, absurde, nécessaire. Un spectacle qui transforme presque malgré nous les spectateurs en adeptes. Non pas d’une idéologie, mais d’un regard : celui qui accepte enfin que tout soit lié, que tout fasse monde, que tout soit digne d’être chanté. Un spectacle d’une générosité rare, d’une intelligence joueuse, d’une beauté discrète et entêtante. Un spectacle qui nous donne envie, oui, d’adorer le monde, même ses détails les plus infimes.
N’en déplaise aux haters.


