
Nebula
Vania Vaneau
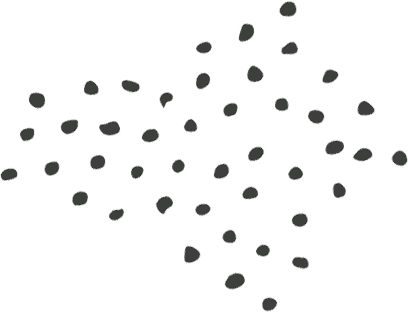
charbons, transes et cosmogonies portatives
Vania Vaneau ne chorégraphie pas comme les autres. Ici le mot performance n’est pas galvaudé. Le mouvement est ritualisé avant même de respecter la rigueur d’une partition. L’engagement est total afin d’atteindre des états de transe. Et ce qui se raconte n’est pas abstrait ou onirique : il s’agit toujours du vivant, du vivant et de nous, comme si nous avions besoin d’un lien avec la vie, et que la danse était un moyen de le faire surgir. Nebula ne déroge pas à la règle. Et même si nous n’avons pas la chance d’assister à la version en plein air, le voyage est radical.
Le protocole est sans détours : un breuvage au charbon, puis l’entrée dans un paysage d’objets et de matières comme autant d’oracles : lentilles de verre, pierres-miroirs, morceaux de charbon, cendres, odeur de feu et de sauge, cercles brûlés, fours solaires. Ce futur post-apocalyptique annoncé convoque paradoxalement les gestes les plus archaïques. On se croirait au Mordor, en plein cœur d’une invocation. Une sorcière, peut-être ; une Cendrillon charbonnée, sûrement ; mais aussi une prêtresse préhistorique (surtout lorsqu’elle projette des pigments sur ses mains pour en laisser l’empreinte dans l’air, comme les mains négatives des grottes paléolithiques, ces signatures renversées où l’on peint en soufflant). Le plateau devient alors paroi, autel, mine, laboratoire, tout à la fois.
On comprend pourquoi Christian Rizzo l’a invitée. Elle se roule dans les terres rares, dans le charbon, comme il avait pu le faire dans les paillettes de Autant vouloir le bleu du ciel et m’en aller sur un âne. Même liturgie de la matière, même désir de se laisser contaminer par elle. Mais Vaneau garde sa voie : chez elle, l’engagement est tellurique, presque organique, sans aucune coquetterie esthétique.
Les lentilles déforment le visage jusqu’à l’altérer en masque cosmique ; la lumière, happée ou diffractée, oscille entre sidération minérale et éclats fragiles. Vaneau porte, verse, broie, étale, assemble : une chorégraphie du faire. Ce solo n’est pas un récit : c’est une fabrique d’images, une cosmogonie portative construite à partir d’un lexique pauvre (cailloux, charbon, cuivre, verre) et pourtant d’une puissance souveraine. Ici, le geste n’illustre pas : il active.
Lorsque la danseuse écrase le charbon pour en faire pigment, agenouillée, on revient à l’aube de l’humanité ; lorsque sa peau noircie se pare de cuivre, l’image bifurque vers quelque mythologie future (corps augmenté, hybride, techno-prêtresse d’un monde dévasté). Tous les temps cohabitent : le commencement, le présent, l’après. Le corps, lui, navigue entre animalité (postures basses, grognements, tensions de jaguar, faune de Nijinski), rite funéraire, flambée d’énergie.
Ce que montre Nebula dépasse largement son dispositif. À travers ces artefacts rudimentaires, c’est notre relation extractiviste au monde qui affleure : le carbone comme mémoire, comme ressource et comme dette. Le rituel devient hypothèse politique. Non une fusion mystique avec la « nature » (fantasme d’innocence, que Vaneau refuse nettement) mais un frottement : le vivant repensé comme collision, résistance, frayage.
La danseuse ne moralise jamais. Elle organise une disponibilité. Elle transforme le plateau en paroi respirante, en sol incantatoire où le corps cherche la braise encore chaude sous les ruines. On sort noirci, oui, mais éveillé : quelque chose du regard s’est déplacé, une strie de temps s’est ouverte, un possible très ancien a surgi dans ce futur calciné.
Nebula, science-fiction préhistorique, cérémonie bricolée, cosmologie en chantier : une pièce qui rallume les braises plutôt qu’elle n’en raconte la fumée. Et c’est beau. Et c’est vivant.


