
Marie Stuart
de Friedrich von Schiller / mise en scène de Chloé Dabert
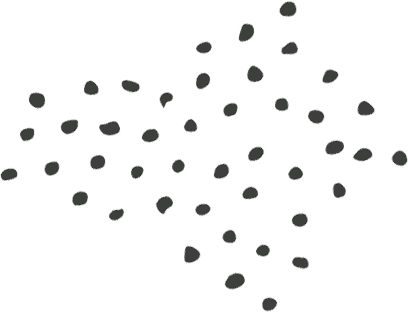
Reines sous cloche
Il y a de l’habileté chez Schiller à intituler sa pièce Marie Stuart. Comme s’il voulait nous faire oublier à qui il se mesure. William Shakespeare, le grand auteur élisabéthain, hante comme un fantôme chaque moment, chaque personnage, chaque mot du drame. La comparaison est inévitable, presque écrasante. Cruauté. Mais Schiller ne cherche pas la fresque ni la tempête. Ici, il y a si peu d’actions, pas de rebondissements spectaculaires, on connaît l’Histoire et tout file droit vers l’exécution. La fin est écrite d’avance, et c’est précisément là que le théâtre commence.
Alors les personnages parlent. Ils parlent beaucoup. Et ils parlent bien. Schiller leur offre le temps pour le faire. Le temps de déplier une pensée, d’hésiter, de se contredire, de s’enfoncer parfois dans leurs propres raisonnements. Ça s’étire, s’organise, prend toute la place. C’est ample, dense, parfois vertigineux. Une langue magnifique, travaillée comme une matière noble. Mais peu de péripéties. Un théâtre de texte, de parole et de positionnement. Un théâtre où l’action est d’abord intérieure, politique, morale.
Et c’est exactement ce que souligne la mise en scène de Chloé Dabert. Sans chichi. Style suisse. Less is more. Efficace, rigoureux, presque pauvre. Le même plateau tout du long : une cage de verre, des panneaux qui montent et descendent, comme un écrin, comme une vitrine de musée. Un espace qui expose autant qu’il enferme. Qui impose une distance, des circulations alambiquées, une géométrie contraignante. On observe les corps comme des pièces rares, sous verre, déjà un peu mortes. Le dispositif dit clairement : ici, on regarde des figures prises au piège d’un système, pas des héroïnes romanesques.
Seule coquetterie, comme un contrepoint assumé : des costumes d’époque. Plusieurs pour un même personnage parfois. Effet défilé. Effet collection. On aura fait notre travail de documentation. Délicieusement désuet. Presque ridicule. Contemporain et classique cohabitent sans jamais vraiment fusionner. Tension ou hésitation ? Premier ou second degré ? Difficile de trancher. Et peut-être est-ce volontaire. Travail d’équilibriste surtout. Car il faut tenir les spectateurs durant trois heures quarante-cinq. Alors on ne décide pas franchement. On ménage toutes les attentes. On ne tranche pas, au risque de rester dans un entre-deux confortable.
Dès lors, tout se joue sur les acteurs. C’est bien à cela que sert le dispositif : ils ne peuvent pas se cacher. Aucun effet pour détourner l’attention. Aucune échappatoire. Et quel cadeau leur offre Chloé Dabert ? Un magnifique cadeau empoisonné. Un cadeau cruel. Car ils sont condamnés à être brillants. À tenir la langue, la durée, la frontalité. À être à la hauteur du texte, sans filet. Pour ceux-là, tout leur art peut se déployer. Ou s’effondrer.
En tête, Bénédicte Cerutti et Océane Mozas interprètent au cordeau deux femmes tenues et piégées par les hommes, bien qu’elles soient reines, peut-être précisément parce qu’elles sont reines. Bénédicte Cerutti impose une Marie Stuart d’une tenue rare, toute en retenue active, en intelligence du texte, en résistance intérieure. Elle ne cherche jamais l’effet, encore moins la séduction : elle creuse. Sa présence est dense, concentrée, presque minérale. Chaque inflexion semble pensée, chaque silence travaillé, comme si le personnage avançait déjà vers sa mort avec une lucidité calme, sans pathos, sans plainte. Avec une infinie subtilité, les deux actrices parviennent à faire entendre la lucidité dans l’aveuglement, l’humour dans la tragédie, la détresse dans la grandeur. Elles incarnent deux stratégies de survie dans un monde gouverné par des hommes qui parlent beaucoup à leur place. Quand on est une femme au pouvoir, on ne dirige pas : tout autour gravite une ribambelle de conseillers-moustiques, experts autoproclamés, stratèges peureux, qui bourdonnent, piquent et empêchent toute décision nette. Voilà la morale limpide que laisse apparaître cette mise en scène de la directrice du CDN de Reims. (Un message à faire passer ?).
Koen De Sutter, en lâche invétéré, est d’un comique imparable. Il excelle dans l’art du retournement, de la couardise élégante, de la compromission souriante. Sébastien Eveno, qui excelle toujours dans les rôles de salaud, fait la moue à outrance, durcit la raison d’État jusqu’à la grimace. Makita Samba joue un violeur maquillé sous les traits d’un fanatique, figure inquiétante et presque trop lisible. On n’est jamais très loin de la caricature. Comme si Chloé Dabert dessinait, à la va-vite, pour les hommes, des moules mâlics. Des fonctions plus que des personnages. Des figures-outils au service du drame des deux reines.
Pour ceux qui sont restés jusqu’à la fin, il y a une réelle satisfaction. Celle d’avoir assisté à une performance d’acteurs. Et c’en est une. Une endurance. Une tenue. Une rigueur. Pour les autres, on ne sait pas. Peut-être sont-ils partis chercher ailleurs ce que cette mise en scène refuse volontairement : le romanesque, le débordement, la chair excessive. Marie Stuart version Chloé Dabert ne cherche pas à séduire à tout prix. Elle expose, elle cadre, elle contraint. Elle attrape le spectateur, et ne le lâche qu’à la toute fin, quand il est déjà trop tard pour discuter.


