
Les Conséquences
Pascal Rambert
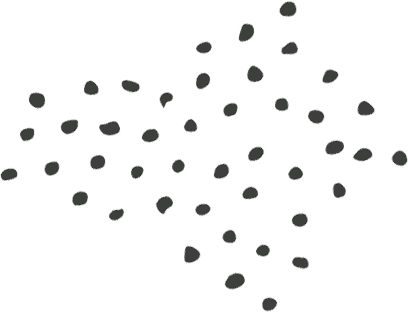
examen de conscience collectif
Pascal Rambert a toujours cultivé l’art des grandes entreprises dramaturgiques. Avec Les Conséquences, première partie d’une trilogie promise à s’achever en 2029, il pousse plus loin encore son obsession du groupe, du temps, et du théâtre comme miroir d’une société sur le fil. Le dispositif paraît simple, presque ascétique : une famille réunie autour de deuils, de mariages, de suicides, sur une durée de huit années condensées dans un espace unique, blanc, nu, saturé de néons et d’attente. Mais sous cette économie apparente se déploie un projet d’une ampleur rare : raconter l’intime comme symptôme du politique, faire du théâtre une salle d’attente où la bourgeoisie regarde, hébétée, la fin de son monde.
La distribution, elle, tient du miracle. Rambert parvient à rassembler autour de lui une constellation d’interprètes dont chacun, chacune, semble incarner un pan de notre mémoire collective du théâtre contemporain. Jacques Weber, monument indétrônable, arrive avec cette autorité tranquille de ceux qui savent que leur présence suffit à ancrer la scène. Sa simple respiration impose silence. Marilu Marini, bouleversante, traverse le plateau comme une apparition funèbre et lumineuse, portant dans son corps tout le tragique des générations disparues et l’humour des Italiens. Stanislas Nordey, récemment revenu de son Feydeau comme métamorphosé, enflamme l’espace avec une énergie neuve, presque juvénile, qui contamine ses partenaires. Arthur Nauzyciel, irrésistible, trouve dans un moment de pure bouffonnerie une liberté rare, un éclat de rire salvateur au cœur du désastre. Anne Brochet accomplit un petit miracle, pas seulement en se relevant d’un fauteuil roulant, mais d’une intensité contenue, un art du silence qui n’appartient qu’à elle. Audrey Bonnet, inlassable prêtresse du verbe rambertien, irradie de maîtrise et de vulnérabilité mêlées. Laurent Sauvage, silhouette lynchienne, se fait rockeur désabusé, témoin inquiet de la décadence d’un monde trop sûr de lui. Ce chœur hétérogène fonctionne comme une série dont on retrouverait les personnages à chaque épisode : après Clôture de l’amour, Répétition ou Deux amis, Les Conséquences poursuit une sorte de saga rambertienne de la parole blessée, des amours effondrées, des consciences en sursis.
Sur le plateau, la pauvreté matérielle est un leurre. Des tables, quelques chaises, du blanc, des néons, et cette immense tente de mariage installée en fond de scène. On croit d’abord à une ironie : un Barnum de fête ratée, un symbole de cette bourgeoisie qui célèbre sans savoir quoi. Mais Rambert sait ce qu’il fait. Derrière cette simplicité se cache une intelligence de la scène qui tient du manifeste. Le mot grec skènè, rappelons-le, signifie « tente ». Ce que Rambert déploie ici n’est pas un décor, mais une scène dans son sens premier : un abri pour les voix, un espace provisoire, fragile, où la parole s’abrite du chaos du monde. La référence à Vitez s’impose, évidemment : comme lui, Rambert cherche l’essence, la nudité, le théâtre réduit à sa nécessité. On se souvient de cette phrase de Vitez affirmant qu’on pouvait jouer tout Molière avec deux chaises et une table. Rambert reprend le flambeau (il l’avait déjà fait dans Deux Amis), mais y ajoute une tension contemporaine : le vide n’est plus une ascèse, il est le symptôme d’un effondrement.
De cette scène dépeuplée surgit un véritable vaudeville contemporain. On court, on s’échappe, on s’aime mal. Adultères, disputes, quiproquos, effusions : tout y est. Sauf les portes qui claquent. Sous la tente, il n’y a pas de murs, seulement des passages, des traversées. Les personnages se frôlent, s’entrechoquent, se perdent de vue pour mieux se retrouver dans une autre configuration du temps. Feydeau et Labiche rôdent, mais transfigurés par la mélancolie de Tchekhov. Les rires ne couvrent pas la fin d’un monde, ils l’accompagnent. On rit parce que c’est trop tard. Parce qu’on sait déjà que le drame est là, tapi derrière les éclats de voix. Le théâtre devient alors un cimetière joyeux, un espace où la légèreté sert de masque à la lucidité.
Cette lucidité est politique. Rambert le sait, et il ne s’en cache pas. Son théâtre ne cherche pas la neutralité. Il met en scène une bourgeoisie qui se pense éclairée, cultivée, progressiste, mais dont chaque phrase trahit la complaisance et la peur. Ces personnages qui se disent de gauche sont médecins, députés, énarques, normaliens, artistes. Ils dénoncent le monde qui les nourrit, mais ne quittent jamais la table du festin. Rambert les regarde sans haine, mais sans indulgence non plus. Il les oblige à parler, à s’exposer, à se contredire. C’est un théâtre de la responsabilité, au sens le plus concret du terme : celui où chacun doit répondre de ses actes, de ses votes, de ses silences. Si l’extrême droite est aux portes du pouvoir, c’est bien, suggère Rambert, que nous avons laissé la clé sous le paillasson.
Dans Les Conséquences, tout se déroule à la veille d’une bascule politique annoncée. On ne sait pas exactement quand, ni comment, mais la menace rôde. Le temps, ici, n’est pas linéaire. Les années passent – mort de la mère, mariage de la première petite-fille, suicide d’une fille, nouveau mariage – mais rien ne change vraiment. Le décor demeure, les vêtements aussi. Le monde est figé dans un entre-deux : avant la catastrophe, après la lucidité. Rambert capte ce moment suspendu où la société s’apprête à glisser vers autre chose, sans parvenir à le nommer. C’est le présent absolu, celui de notre époque, incapable de futur.
Certains reprochent à Rambert de se répéter, de recycler la même langue, les mêmes obsessions. C’est ignorer que cette répétition est le cœur même de son projet. Rambert écrit en mouvement, littéralement : dans un train, dans un avion, entre deux villes, deux tournées. Il prend des notes, aligne des fragments, capte des phrases. Son théâtre est un journal de bord en acte, une écriture de la mobilité, du flux, de la fatigue aussi. On entend sa voix dans celle de ses personnages. Il est là, omniprésent, non pas comme auteur tout-puissant, mais comme conscience collective. Les Conséquences est son autoportrait éclaté, sa manière de dire « je » à travers les autres.
Ce « je » passe souvent par les femmes. Chez Rambert, le drame naît du féminin, de cette capacité à ressentir, à aimer, à se battre. Les hommes, tous en costume noir (adéquat pour passer du mariage à l’enterrement sans quitter la fonction), semblent interchangeables, prisonniers d’une neutralité qui les rend spectateurs. Les femmes, elles, sont en robe de soirée, éclatantes, tragiques, vivantes. L’une aime, l’autre tombe malade, une autre se marie ou meurt. Leurs corps racontent ce que les mots taisent. On pense à Pina Bausch, bien sûr, et pas seulement à cause des costumes. On pense à ces femmes qui dansaient la douleur jusqu’à l’épuisement. Ici aussi, elles portent le monde, elles le maintiennent debout. Rambert leur rend hommage sans didactisme, simplement en leur laissant la place, le temps, la parole.
Sous l’apparente gravité, Les Conséquences parle d’amour. D’amour au pluriel, d’amour coupable, d’amour libre, d’amour fatigué. Rambert redéfinit le romantisme à l’ère du désenchantement : aimer, c’est accepter les conséquences. Et dans un monde où tout discours sur la responsabilité semble vidé de sens, il rappelle que le théâtre peut encore être cet espace de réparation symbolique, où l’on mesure ce qu’on fait aux autres, à soi-même, au monde.
En définitive, Les Conséquences est bien plus qu’un spectacle. C’est un diagnostic. Celui d’une société en apnée, d’une culture qui doute de sa puissance, d’une gauche bourgeoise qui se regarde parler. Mais c’est aussi un appel, un sursaut, une manière de dire que la parole – encore, toujours – reste la seule arme contre l’endormissement. Rambert n’invite pas à se complaire dans le constat ou dans la nostalgie de la gauche caviar à la manière d’un Découflé : il exige qu’on assume. Le théâtre, chez lui, ne sauve rien, mais il empêche de sombrer sans témoin. Et c’est déjà beaucoup.
Les Conséquences, en réunissant onze interprètes d’exception dans un dispositif d’une intelligence implacable, confirme que Pascal Rambert est l’un des rares à penser encore le théâtre comme un art du temps, de la durée, de la responsabilité. Dans cette tente blanche, sous ces néons crus, se rejoue notre propre histoire : celle d’une humanité qui, au bord du gouffre, parle encore, parce que c’est tout ce qui lui reste à faire.


