
L'hôtel du libre échange
de Feydeau, mis en scène par Stanislas Nordey
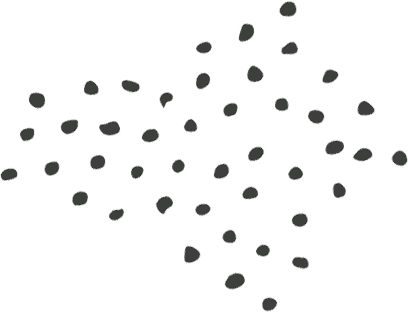
Nordey plume Feydeau
Les critiques ne sont pas bonnes, il faut l’avouer. Et sans doute parce qu’on attendait de Stanislas Nordey qu’il ne dérange pas. Qu’il serve Feydeau tel qu’on le croit figé, dans la tradition molle du vaudeville, ce petit genre qui rassure, distrait, anesthésie. Mais Nordey n’est pas un serviteur docile. Il est metteur en scène au sens le plus noble. En s’emparant de L’Hôtel du Libre-Échange, il ne se contente pas d’exécuter, il propose. Il dérange parce qu’il déjoue les attentes. Il prend le texte au mot, le déshabille, l’écoute autrement.
Feydeau a vieilli. Il serait vain de le nier. Comment rire, aujourd’hui, de cette misogynie en contrepoint, de cet espoir répété d’être enfin débarrassé de sa femme ? Comment ne pas être frappé par la brutalité ordinaire de ces personnages, par leur bêtise bruyante et leur libido triste ? Nordey ne cherche pas à faire oublier cela : il le souligne. Il exhibe la fadeur féroce de ces vies. Et révèle que, si nous rions encore, c’est sans doute de nous-mêmes, inconsciemment. Un rire d’angoisse presque. Sinon rire de ces bourgeois ridicules, c’est souvent s’exonérer d’en être. Or Nordey nous tend un miroir. Et son reflet n’est pas flatteur.
Ce n’est pas la première fois qu’il s’aventure chez Feydeau. Il avait déjà monté La Puce à l’oreille, en dissolvant la comédie dans une matière sonore et visuelle à la lisière du rêve. On y croisait déjà des insectes, petites figures de la paranoïa conjugale. Ici, ce sont les autruches qui prennent le relais : dans les costumes, les poses, dans ce portrait monumental qui surplombe la scène, elles sont partout. L’autruche, cet oiseau qui court sans voler, qui enfouit sa tête dans le sable, croyant ainsi échapper au danger. Quelle métaphore plus juste de notre posture de spectateur ?
Il y a dans cette mise en scène un goût affirmé pour la farce, mais une farce acide, tendue, dérangeante. Une farce qui ne nous absout pas, mais nous expose.
Beaucoup viennent à Feydeau pour oublier. Nordey les force à se souvenir. Car s’il y a du cabaret, du music-hall, du plumesque, ce n’est jamais pour flatter. Le jeu est volontairement outré, caricature à la Maillan, mais étiré, hurlé, jusqu’à la rupture. Les murs sont des faisceaux lumineux, les chambres n’existent plus que par un espace imaginaire. Les acteurs se croisent sans se voir. Le réalisme est aboli, les conventions détruites. Il ne reste que la parole, et cette parole devient partition. Voilà qui ne peut que décevoir les esprits paresseux.
On pourrait écouter cet Hôtel du Libre-Échange les yeux fermés. Ce ne serait plus une pièce, ce serait une sonate. On y entend des glissements, des échos, des effets de langue où l’époux devient parasite. Une lecture lacanienne, presque, où les mots nous devancent, nous embrouillent, nous exposent, poétisent. Le cocu n’est plus ridicule : il est tragique. Le mari adultérin ne fait plus rire : il s’étouffe dans son désir impuissant.
Alors les autruches rêvent de fuir. Mais Nordey les empêche de baisser la tête. Il les force à regarder. Ce spectacle ne cherche pas à divertir. Il cherche à secouer. Il nous dit que l’échappatoire du rire bourgeois n’est plus possible. Que le rire est une arme, mais qu’il faut savoir où elle pointe. Nordey, en cela, fait du politique autrement. Il convoque Feydeau non pas pour s’y complaire, mais pour l’ausculter. Et ce qu’il trouve, dans les replis grinçants du texte, c’est une parole de notre temps : désaccordée, inquiète, burlesque, désespérée.
Ce théâtre-là nous rend éveillés. Non seulement parce qu’il nous oblige à penser, mais aussi parce qu’il nous interpelle à pleine voix. À l’ancienne, sans micros, les acteurs projettent, gueulent, désincarnent. Et cette énergie nous secoue plus sûrement que bien des artifices techniques.
Il fallait du courage pour faire ça. Il fallait ne pas avoir peur de décevoir les amateurs de portes qui claquent. Il fallait, aussi, une troupe capable de suivre cette métamorphose. Hélène Alexandridis, Claude Duparfait, Anaïs Muller, Raoul Fernandez et les autres s’y abandonnent avec une générosité rare. Ce n’est plus du boulevard, c’est une fable. Une fable féroce et féconde. Et si certains restent à la porte de cette étrange auberge, tant pis. Les autres, eux, auront vécu un vrai moment de théâtre : une nuit éclairée par la lucide absurdité de notre monde.


