
Elémentaire
Sébastien Bravard
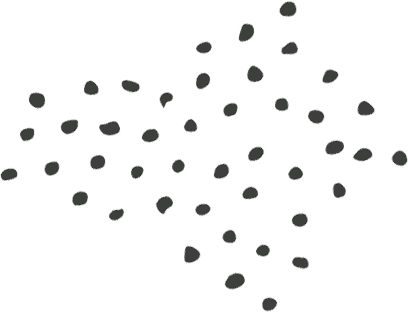
la leçon bien apprise, ou l’élégance de l’entrave
Dans Élémentaire, Sébastien Bravard mêle théâtre et autobiographie pour retracer une année charnière de sa vie : celle où, après les attentats de 2015, comédien en quête de sens, il choisit de devenir instituteur. À travers cette décision radicale, il raconte ses premiers pas dans l’Éducation nationale, sa confrontation avec la classe, les enfants, l’institution, et surtout ce qu’enseigner implique lorsqu’on croit encore, peut-être naïvement, qu’il faut transmettre quelque chose de vivant. Le spectacle se présente comme un seul-en-scène où l’artiste, à la croisée de deux vocations, tente de dire ce que signifie aujourd’hui être un maître d’école.
Il est des spectacles dont l’ambition, pourtant sincère, se heurte à la forme même qu’ils empruntent. Élémentaire de Sébastien Bravard en est l’illustration exemplaire. Voici un seul-en-scène qui se rêve vivant, poreux, interactif, mais qui, dans sa stricte orchestration, finit par s’apparenter davantage à une leçon minutieusement préparée — comme on en rédigerait une pour une classe de CM1 un peu dissipée.
Tout est agencé avec une application irréprochable. Chaque phrase semble pesée, chaque variation de ton millimétrée, chaque rupture de rythme savamment calculée. Ce théâtre-là n’est pas un théâtre de la surprise ou de l’improvisation sensible ; c’est un théâtre de la démonstration. On y avance par paliers, comme dans un exposé pédagogique dont on cocherait consciencieusement les jalons. Le comédien, impeccable de diction, manie son texte comme un professeur appliqué son cahier de progression. Rien ne dépasse. Tout est corseté. Peut-être trop.
Le spectateur est invité à participer, à s’émouvoir, à répondre — mais c’est une invitation sous haute surveillance. Une fausse liberté, un simulacre d’interactivité. On nous questionne sans nous laisser le temps de répondre. L’espace scénique devient une classe à sens unique, où l’on feint d’interroger alors que l’on énonce. L’illusion d’une communauté momentanée ne parvient jamais à percer la membrane invisible qui nous sépare du texte — omniprésent, impérieux, trop bavard parfois, même si les anecdotes peuvent faire sourire.
Car c’est là que réside l’autre écueil de Élémentaire : dans cette logorrhée, certes brillante, mais peu perméable. Le flot verbal finit par saturer l’écoute. À vouloir tout dire, tout expliciter, tout baliser, le spectacle s’emmure dans sa propre rhétorique. Il n’y a plus de creux, plus de silence, plus de respiration. Or c’est dans l’ellipse, dans l’interstice, dans le non-dit que le théâtre respire. Ici, on étouffe un peu — élégamment, mais tout de même.
Et pourtant. On sent l’intelligence de la proposition, la sincérité du propos, l’ardeur d’un artiste qui veut transmettre, trouver du sens. Mais on aurait tant aimé que cette transmission emprunte d’autres chemins. Qu’elle s’autorise à lâcher prise. Qu’elle s’abandonne à l’inattendu, au trivial, à l’imparfait. Qu’elle s’inspire, justement, de ce que l’enfance a de plus subversif : sa capacité à déborder le cadre, à détourner la consigne, à répondre à côté avec une grâce désarmante.
On aurait voulu pouvoir écouter Élémentaire comme un enfant écoute un récit — à moitié, avec les yeux dans le vide, laissant divaguer son imaginaire à la faveur d’une phrase, d’un mot, d’une sensation. Mais ici, tout est fixé. Cadenassé. À tel point qu’on se prend à rêver d’un accident de plateau, d’un trou de mémoire, d’une panne d’éclairage — quelque chose, n’importe quoi, qui fissurerait la surface trop lisse du dispositif.
Élémentaire n’est pas un mauvais spectacle. C’est un spectacle savamment fabriqué. Trop savamment peut-être. On y sent le soin, le respect du public, la volonté de bien faire — et c’est ce qui rend la chose à la fois irréprochable… et frustrante. À trop vouloir maîtriser, on finit par assécher. Et le théâtre, ce n’est pas un devoir surveillé. C’est une expérience vivante, inquiète, imparfaite, offerte.
Sébastien Bravard aurait tout à gagner, peut-être, à désapprendre un peu. À désordonner ses phrases. À oublier son texte. À se perdre. Et à laisser le spectateur le rejoindre non par la rigueur du propos, mais par l’inattendu du geste.


