
Broadway sur Seine ?
La comédie musicale à la française : mythes et réalités.
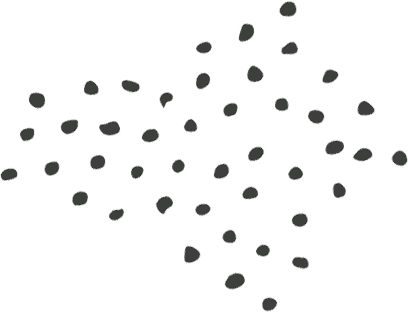
Les points sur les i.
Avec West side story (1957), Jerome Robbins et Leonard Bernstein créent le modèle de la comédie musicale américaine : un spectacle total, où la narration se développe aussi bien par la danse, la chanson, que le théâtre. Ainsi, la scène de combat entre les Jets et les Sharks est-elle seulement dansée, pas chantée, et sans elle, l’histoire est incomplète. Si la structure s’est étendue à Londres dès les années 60, avec Andrew Lloyd Webber en figure tutélaire, à Paris, où l’opérette a régné jusqu’aux années 50, le modèle semble ne pas avoir pris. La création parisienne qui joue, danse et chante s’en tient au théâtre musical et au cabaret. Retour sur de fausses idées.
Par Charles A. Catherine
La fausse comédie musicale « à la française »
Quand on parle de comédie musicale en France, on pense à Notre-Dame de Paris, Le Roi Soleil, Mozart l’opéra rock ou à Starmania. Improprement, si l’on suit la règle Robbins/Bernstein : dans les productions françaises, les parties théâtrales servent de liens entre les numéros chantés, la narrativité est toute relative, et la danse n’est que partie de la mise en scène, pas de la narration – en d’autres termes : réduite à la déco. Les Demoiselles de Rochefort (Jacques Demy, 1967) aurait pu être le coup d’envoi d’une vague française de comédies musicales à l’américaine, mais ni le cinéma ni le théâtre ne s’approprièrent l’exercice par la suite. Les années 70 sont le moment d’un renouvellement du théâtre musical, autour de Claude-Michel Schönberg (La Révolution Française, 1973), Michel Berger (Starmania, 1978) ou Michel Legrand (Les parapluies de Cherbourg, 1979), mais la France s’entiche alors pour l’opéra-rock : narration simplifiée, musique amplifiée, danse réduite à la mise en scène des numéros chantés. Même le modèle économique est inversé : à Broadway, un spectacle à succès mène à l’enregistrement d’un disque ; à Paris, c’est le succès du disque qui incite à créer le spectacle. La presse parle alors de comédie musicale à la française ; il s’agit en fait de l’avènement du spectacle musical, sans rapport avec les productions américaines. Le meilleur exemple en est Les Misérables, créé en France par Schönberg en 1980, qui devra passer la Manche (1985) puis l’Atlantique (1987) pour prendre sa forme de comédie musicale à l’américaine qui lui assurera succès mondial et pérennité. L’auteur créera d’ailleurs toutes ses pièces suivantes (Miss Saigon – 1991, Martin Guerre – 1996, Marguerite – 2006) directement dans le West End.
La danse n’est pas pour autant absente des spectacles musicaux français, et le travail des chorégraphes s’inscrit de plus en plus souvent dans la narrativité, à l’instar du travail de Kamel Ouali, figure dominante de l’exercice : des scènes uniquement chorégraphiées apparaissent dans Les Dix Commandements ou Le Roi Soleil, pour mieux planter le contexte. Les productions intègrent toujours davantage de danseurs et d’artistes polyvalents, rejoignant par instants les exigences de la machinerie Broadway. Artistiquement, cependant, ces spectacles sont davantage tournés vers la variété et l’urban jazz décoratif plutôt que vers la grande musique et la modern dance narrative : on reste donc loin du modèle Robbins/Bernstein.

Remontage, re-création, création
Le musical américain trouve pourtant sa place à Paris : dès les années 80, les théâtres parisiens importent en nombre les succès de Broadway et du West End. Mogador, sous la direction de Fernand Lumbroso, se fait le grand spécialiste de l’adaptation, inaugurant le genre avec un resplendissant Cabaret en 1986, confié à Jérôme Savary, salué d’un Molière – le premier du genre.
La traduction du livret et l’adaptation des paroles sont alors incontournables et particulièrement choyées. Avec le temps, une dizaine de traducteurs se fait un nom sur la scène parisienne, d’Eric Taraud à Stéphane Laporte en passant par Nicolas Nebout. La mise en scène est confiée à des artistes venus majoritairement du théâtre, même si quelques chorégraphes tirent leur épingle du jeu ; tous suivent en tout cas l’original new yorkais pour ce qui est du résultat final. Le procédé s’étend à un petit groupe de théâtres parisiens qui font du spectacle musical leur marque de fabrique : Marigny, le Théâtre de Paris, les Folies Bergère, le Casino de Paris, le Déjazet, suivis plus récemment par le Théâtre des Nouveautés, la Pépinière, Bobino, le Châtelet.
Quid de la production d’œuvres originales ? Si le théâtre musical pullule partout, et si le spectacle musical conquiert le grand public hexagonal, la comédie musicale en tant que telle peine à exister. Avec la nomination de Jean-Luc Choplin par Bertrand Delanoë à sa direction en 2005, le Théâtre du Châtelet devient pour Paris une nouvelle pièce maîtresse à jouer sur l’échiquier mondial de la comédie musicale. Il produit de nouvelles versions ou remonte des pièces rares de Bernstein, des œuvres des incontournables Hammerstein II & Rodgers, le monument My Fair Lady, et surtout le répertoire de l’enfant terrible de Broadway, Stephen Sondheim, que les critiques de New York nous envient. Nuance de taille : les metteurs en scène, auteurs, chorégraphes, directeurs musicaux, triés sur le volet, viennent tous de l’international, et l’anglais règne en maître. La création est donc moins française qu’en France.
Avec An American in Paris (2015), le Châtelet frappe un grand coup : adapter sur scène un classique d’Hollywood avant Broadway, en respectant toutes les règles de l’exercice, dans une mise en scène monumentale confiée au britannique Christopher Wheeldon, bien connu pour son travail au New York City Ballet, repris par tous les ballets de l’hexagone. Couronnement suprême : la pièce initiée par Choplin se voit couronnée de 4 Tony Awards. Une première. Le Châtelet creuse son sillon en invitant de grands noms de la musique sur ses plateaux pour de grandes mises en scène musicales, de Christopher Renshaw à Damon Albarn, en passant par Robert Carsen ou Juliette. Une démarche qui vaut au théâtre reconnaissance internationale et succès public.

Guerre pour le titre de « Broadway-sur-Seine »
Alors que Choplin faisait entrer le Châtelet dans l’ère du musical, Stage Entertainment reprenait Mogador, avec l’intention d’y inviter les grands succès de Broadway, en se contentant désormais de les traduire : la flamme de la création scénographique originale parisienne pour la comédie musicale s’éteint. Le Roi Lion, Mamma Mia !, Sister Act, La Belle et la Bête, Cats connaissent des succès publics avérés, et le théâtre tient le rythme des scènes de Broadway : plusieurs mois d’exploitation, grand nombre de spectateurs, communication d’envergure passant par la redécoration des extérieurs. Les aficionados s’y retrouvent, leur désir des scènes new yorkaises savamment entretenu par l’ersatz francophone.
Alors, qui du Châtelet ou de Mogador mérite le plus le titre de Broadway-sur-Seine ? L’un en cultive l’excellence et entre en concurrence, l’autre en cultive la popularité et l’attractivité. Chacun, selon ses goûts – et ses moyens – fera son choix, mais en ce qui concerne la comédie musicale française inspirée de Broadway, la palme revient au Châtelet, bien isolé dans le paysage français. Un constat renforcé par le fait que la grande majorité des artistes est recrutée à Londres, Berlin ou New York.
L’engouement pour la comédie musicale a créé l’affluence dans les centres de formation spécialisés (ECM, EPCM, AICOM) ; les cours de théâtre (Conservatoires, Cours Florent) et écoles de danse (AID, studio Harmonic, centre Rick Odums) ont toutes ajouté un cursus danse/chant/comédie : en théorie, les artistes pluridisciplinaires ne manquent pas. Mais si ces apprentis, choisis pour leur motivation plus que pour leur excellence technique, finissent par grossir les rangs des casts de Mogador, où la variété bat son plein, ils n’entrent jamais dans les productions du Châtelet, qui ne retient que des artistes dignes des maisons d’opéra.
La comédie musicale française a donc encore du chemin à faire pour rivaliser pleinement avec l’américaine.
Liens utiles :
◊ Stage entertainment
◊ Théâtre du Châtelet


