
A l'ombre d'un vaste détail, hors tempête
Christian Rizzo
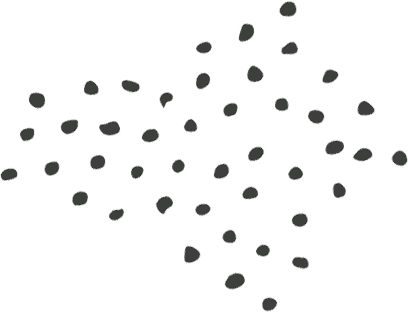
la précision des ombres
Christian Rizzo c’est aujourd’hui une pointure de la danse contemporaine française, un des pères de la non-danse, même si l’étiquette reste absurde : ça danse chez Rizzo, ça n’a jamais cessé de danser. Et le voilà débarrassé de l’institution, de ces directions qui engloutissent le temps et l’élan. Ce soulagement, pourtant, ne saute pas aux yeux au début de sa nouvelle pièce. Plateau nu, tapis blanc, pendrillons noirs, un écran de surtitrage à jardin. Le texte de Célia Houdart tombe en fragments réguliers, monotones malgré la tentation de la poésie. Les lumières sont sombres, presque contradictoires avec le blanc du sol. La musique, répétitive, déroule une lente coulée ambient. Les danseurs, en noir intégral, sans fioritures, sans falbalas, ne surgissent que par éclats de peau. Il faut lutter pour rester accroché. C’est volontaire.
Rizzo travaille aux portes du rêve. Il joue cette somnolence, ce moment où l’on pique du nez, ce moment où le corps cède. Les interprètes chutent, s’abandonnent, répondent à la gravité avec une douceur presque déconcertante. Des pas de chats. Pas de fracas, pas de drame : quelqu’un accueille, amortit, accompagne. Cette succession d’images suspendues, comme de véritables clichés de plateau, compose un film intérieur plus qu’une fresque chorégraphique. Si peu d’éléments, et pourtant tant de prises pour l’inconscient. Des détails minuscules, des gestes affleurants, des lueurs qui ne durent pas. Au crépuscule, entre chiens et loups, le sens se fabrique dans l’intervalle.
Et ce sens, grande force du spectacle, est profondément communautaire. Comme si derrière le minimalisme se cachait une utopie discrète : des corps qui se tiennent, qui s’écoutent, qui se rendent disponibles. Sous les arbres d’un jardin imaginaire, sous une lumière qui filtre et tremble. Caty Olive, dans cette pénombre habile, sculpte des zones de visibilité incertaines, des passages, des seuils. Le temps même que mettent les projecteurs à s’éveiller devient dramaturgie.
Cette communauté, Rizzo ne la décrète pas : il la construit. Il réunit une autrice, une créatrice lumière, des compositeurs, des interprètes, mais refuse la posture du maître d’œuvre omniscient. Il préfère le terrain de la rencontre. La pièce devient alors un espace d’attention partagée, une constellation tenue par la fragilité.
À mesure que la pièce progresse, tout s’affine. Le plateau vide devient lisible. Les gestes minuscules prennent de l’ampleur. De possibles rondes apparaissent, des duos s’esquissent, des portés s’inventent et se rétractent. Les corps avancent comme dans une maison où chaque pièce serait une émotion. Rien n’est décoratif : la danse se tisse au millimètre, dans la lenteur, dans le presque rien. Le texte projeté, parfois trop abondant, crée un frottement stimulant entre le lisible et le sensible. Le spectateur doit choisir. C’est cette tension qui fait œuvre.
La mélancolie, présente comme une ombre stable, n’alourdit jamais. Elle donne du poids aux gestes, du grain aux relations. On pense à un jour d’été qui s’achève, à une lumière qui refuse de disparaître. À cette tristesse qui n’interdit rien, qui ouvre plutôt une lucidité tendre.
Rizzo signe là une pièce sans emphase, d’une exigence rare, mais d’une hospitalité profonde. Une pièce où chaque geste posé devient promesse, où la douceur n’est pas un remède mais une position politique. Dans une époque crispée, voir un groupe de corps tenir ensemble par la seule rigueur de l’attention est un acte qui compte.
Il faut aller voir cette pièce. Pour la précision, pour la beauté ténue, pour cette manière unique de réhabiliter le détail comme moteur d’un commun. Pour cette lumière lente, ces chutes reçues, cette danse qui avance sans jamais écraser. Pour se rappeler que la scène la plus nue est parfois celle où l’on voit le mieux.


