
Sauve qui peut (la Révolution)
d'après Thierry Froger, mis en scène par Laëtitia Pitz
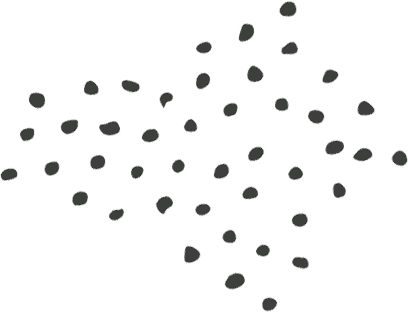
juste un spectacle, un spectacle juste
Sauve qui peut la révolution et la révolution est entre parenthèses : c’est l’histoire d’une commande d’un film faite à Jean-Luc Godard. Un film pour les célébrations du bicentenaire de la révolution française. Un film qui ne se fera pas. Et cette absence, ce film fantôme, devient la matière même du spectacle : non pas raconter une œuvre, mais raconter une gestation, une impossibilité, un chantier qui tourne à vide.
Godard intéresse le théâtre, l’inspire. Ce n’est pas la première pièce qui tentera d’évoquer le cinéaste et sûrement pas la dernière. Mais voilà bien un écueil : comment faire d’une matière cinématographique un matériau pour le plateau ? D’autant qu’une bonne part de la matière est entrée dans la conscience collective, élevée au rang de chef d’œuvre quasi sacré, intouchable donc. D’autant aussi que la matière est inégale, parfois à la limite de la blague sinon de la vacuité. Le risque avec ce genre de projet, c’est le fan service : donner à entendre la musique du Mépris, citer les bons mots, les bonnes phrases à l’humour cinglant et cynique du vieux misanthrope, déclencher le petit sourire de connivence du public qui reconnaît et qui se reconnaît. Le risque c’est aussi de rester en surface et de susciter une frustration, une attente déçue d’une apparition qui n’aura jamais lieu. Car le maître est mort. Et il nous manque. Et ce manque peut devenir un alibi, une nostalgie confortable.
La proposition de Laëtitia Pitz n’évite rien. Bien au contraire. Elle va se jouer de tout cela. Elle va tout risquer. En 5 heures. Dont une heure d’entracte. Folie. Folie d’offrir à ses spectateurs un tel choix : rester ou partir. Ceux qui restent sont forcément conquis. C’est rare qu’on nous permette de manifester notre adhésion de la sorte. Audace folle de faire fleuve, de prendre le temps donc.
Tout commence en bifrontal, c’est la tendance du moment. Terrain de tennis dessiné au sol. Comme si l’on allait assister à un match : échanges, renvois, balles perdues, points qui n’en finissent pas. Couleurs primaires qu’on aurait pu voir dans La Chinoise. Table avec micro comme si on était à la radio, comme si on allait “annoncer”, “expliquer”, “informer”, alors que le spectacle va surtout brouiller, déplacer, monter, démonter. Et puis l’un des acteurs chauffe la salle comme un DJ de province : petit décalage trivial. Audace encore une fois d’être populaire avec un sujet éminemment élitiste, faussement élitiste. Car Godard, au fond, c’est aussi ça : du patrimoine devenu code social.
Tout cela sous l’égide de Brecht : les artifices seront montrés constamment. Les effets sonores lancés en direct depuis la table. Chacun dit quel rôle il joue. On annonce, on montre, on affiche. Il n’y a plus de représentation au sens hypnotique : on n’est pas “pris”, on est “avec”. Immersif, mais pas participatif : on n’a pas à monter sur scène, merci. On est sur un banc de montage. Et on procède par collage. Comme Godard pouvait le faire : juxtaposer, faire se cogner deux choses, produire du sens par la collision plutôt que par le récit. Le spectacle ne cherche pas à “imiter” Godard : il essaie d’en adopter le principe actif.
Plusieurs histoires se déroulent en parallèle, s’entrecroisent même. Le film qui ne se fera pas, la révolution française racontée par Michelet ou Büchner, l’histoire d’amour plus ou moins fantasmée ou fictive entre JLG et Rose Ava Pierre, les rencontres entre Duras et Jean-Luc Godard, les vœux des Présidents de la Cinquième République. Et tout tient parce que ça ne tient pas. Le spectacle est hanté par la psychanalyse mais n’y sombre jamais.
Il semble plutôt dire que le monde a changé et n’a pas changé. Car « la révolution, on sait quand elle commence mais on ne sait pas comment la finir ». Et aujourd’hui encore il semblerait qu’une révolution soit toujours nécessaire, ou en train de se faire, sans jamais aboutir, comme ce film, comme la terre qui effectue une révolution autour du soleil chaque année. Retour perpétuel au point de départ. Un tour pour rien.
Tout cela est très fin, humaniste, exigeant. On ne nous prend pas pour des idiots. On rit aussi, franchement, parce que le spectacle n’a pas peur de la joie du plateau. Et cette joie, paradoxalement, rend la pensée plus vive : ça circule.
Alors il y a quelques défauts : parfois l’incarnation des personnages est un peu bancale, imparfaite ; parfois la femme au plateau semble sous-employée ; parfois la musique pop (Radiohead, Nirvana, les Rita Mitsouko) dans la dernière partie semble comme une béquille pour nous garder là ; surtout, Büchner arrive comme un cheveu sur la soupe, inutile. Mais ces défauts ont presque quelque chose de cohérent : ils appartiennent à une forme qui accepte l’excès, le débordement, le risque de rater, plutôt que la petite réussite propre et refermée.
Reste donc un véritable moment de théâtre : où l’on fait beaucoup avec peu, où l’on rit de bon cœur, où l’on réfléchit énormément, le cerveau en alerte. Un spectacle qui ne demande pas seulement d’être regardé, mais d’être traversé. Et qui, au fond, réussit son pari : faire exister, sur scène, non pas Godard comme icône, mais Godard comme méthode, comme problème, comme moteur.


