
Dialogue avec ce qui passe
de Nicolas Doutey mise en scène par Adrien Béal
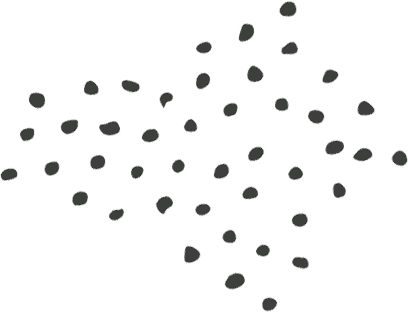
On peint, donc on pense (à autre chose)
Sur le plateau : une immense palissade blanche. Une palissade, c’est pratique. Ça dit “chantier”, ça dit “on construit”, ça dit “on cache”, ça dit “c’est provisoire” et “c’est conceptuel”. En France, on aime bien le provisoire conceptuel.
Et les voilà qui entrent. Avec des rouleaux à peinture. De la peinture bleu ciel. Bleu ciel : cette couleur qui, en théorie, ouvre l’espace, promène l’esprit, donne de l’air. Sauf qu’ici, le ciel est appliqué au rouleau, comme une tâche administrative. On peint l’évasion en couche uniforme. On badigeonne le rêve. C’est beau comme une promesse de start-up.
Et ça commence à parler. Mais parler pour ne rien dire, ou plutôt : dire des choses quotidiennes, sans envergure, avec un air extrêmement détaché, neutre, presque halluciné, presque sous psychotropes. Un ton de fin de soirée permanente où même l’ironie a la gueule de bois. C’est fumeux mais sans fumée.
Alors l’esprit divague, forcément. On pense immédiatement à Tati, c’est joliment absurde. On pense à Ionesco, ça a un côté désuet. On pense aux Deschiens, on ricane mollement. On pense aux Chiens de Navarre et à leur raclette mais sans la férocité. Peut-être un petit côté métaphysique aussi. On pense à Philippe Quesnes, mais il n’y a pas de scénographie. Enfin si : il y a “l’idée” qu’il n’y en a pas. C’est plutôt vide. Esthétique minimale : comme ça, on ne risque pas le mauvais goût. C’est sûr. Efficace dans la sobriété. Et tout est dans du coton. Stupéfiant.
La France est le premier pays consommateur d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. Le saviez-vous ? Triste record. Sur scène, on dirait que l’info a été prise comme consigne de jeu.
Quelle prouesse, tout de même, de nous faire penser à tous ces noms. Mais cette prouesse a un prix : elle signifie qu’il n’y a ici rien de neuf. Et la comparaison avec ces maîtres est parfois cruelle, assassine.
Alors on s’attache à cette palissade, magnifique appui de jeu. Elle justifie la présence des personnages au plateau, elle leur donne une certaine consistance, et surtout elle signifie qu’il n’y a pas de quatrième mur : on nous parle, on est intégré dans le spectacle, même si, finalement, on n’a pas la parole. Immersif mais pas participatif. Ouf. Tant mieux.
Et ils peignent mal. Ils recouvrent la surface. Mal. Et ce “mal” pourrait être une trouvaille : peindre mal comme on vit mal, comme on communique mal, comme on passe le temps en faisant semblant de l’habiter. Peindre mal comme pour marquer que le temps passe. Le temps passe, oui. Beckett ?
On riait, et puis maintenant on ne rit plus. Ça dure. Et ça dure. Ça ne va nulle part.
Les errances de l’écriture de plateau, peut-être, quand on s’appuie sur des improvisations sans réelle motivation autre qu’occuper le temps et l’espace. On pense à Mai 68 : ils voulaient la liberté d’expression. Ils ont eu les moyens, les moyens d’expression. Tout pour communiquer. Mais a-t-on quelque chose à dire ? Nous a-t-on donné les moyens d’avoir quelque chose à dire ?
Alors que les interprètes entrent, sortent, peignent, repassent, re-repassent, on s’en vient à penser au doomscrolling infini : comment il pourrait s’incarner au théâtre. La mécanique est la même : de l’action sans conséquence, du mouvement sans destination, un flux de micro-événements qui ont l’air d’exister mais qui ne produisent rien, sinon la sensation d’avoir été occupés. On pense à beaucoup de choses puisqu’il n’y a pas une chose à laquelle penser. Economie de l’attention.
Et là, on entend une phrase : “les représentations deviennent autonomes de ce qu’elles représentent”. Intéressant. Oui. Mais elles deviennent aussi autonomes de ceux qui les regardent. Et c’est peut-être ça, le vrai “dialogue avec ce qui se passe” : un dialogue où “ce qui se passe” a oublié qu’on est là. Un spectacle qui s’autogère, qui tourne tout seul, comme une playlist d’ambiance. On assiste à une autonomie. Et nous, on devient le décor.


