
Pylade, étude pasolinienne
Sylvain Creuzevault d'après Pier Paolo Pasolini
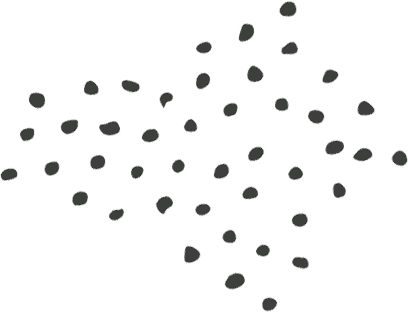
Pasolini fait école
Comme sur les podiums, les plateaux de théâtre sont traversés de tendances. Les dispositifs, les gestes, les “formes” se refilent comme des coupes : on les voit réapparaître, se durcir, se vider, puis redevenir désirables. Et ici, après Gosselin ou Chavrier par exemple, c’est le grand retour du bifrontal. Et ce n’est pas là un caprice. C’est un dispositif intelligent, parce qu’il travaille à double tranchant : il déjoue la théâtralité (on se voit regarder, on se surprend en train de consommer) et il nous assigne une place politique, ou à tout le moins civique. Nous voilà renvoyés à l’idée de polis : nous sommes là, en vis-à-vis, comme des citoyens rassemblés, des témoins muets de la tragédie, presque des comparses par notre simple présence. Le bifrontal fabrique une communauté, même fragile, même provisoire. Il fabrique aussi une gêne : on est vu, on se sait vu, et l’on n’a plus l’excuse confortable de l’ombre.
Creuzevault nous accueille, nous place, nous parle. C’est bon enfant. Ultra détente. Baskets rouges, trous dans le sweat-shirt : le metteur en scène comme grand frère sympathique, comme animateur de séance, comme chef de bande. Il y a quelque chose du prof cool, et donc du pouvoir qui se déguise. Et pourtant, au sol, une trace de sang. D’emblée un signe. Une petite alerte. Cette familiarité est louche, ou plutôt elle n’est pas innocente : elle est une manière de mettre l’institution en scène, de jouer la proximité pour mieux tenir le groupe, pour fabriquer l’adhésion avant même d’avoir commencé. Les acteurs nous regardent nous installer. Tout est déjà là : l’observation, la surveillance, le tribunal diffus du regard. Ce moment où le public croit encore être libre, et où l’on comprend qu’on est déjà pris dans la situation. Ils sont en beige, la couleur qui n’en est pas une, couleur passe-partout, couleur de l’uniforme discret, couleur du consensus. Encore une tendance ? Ou un symbole, au contraire : l’égalisation des corps, la neutralisation des singularités, l’effacement du “personnage” au profit d’une troupe, au profit d’un chœur. Beige aussi comme “neutralité” forcée : la promesse que personne ne dépasse, que personne ne détonne trop.
Pylade de Pasolini, c’est ce désir typiquement pasolinien de prendre un vieux drame, de lui inventer une suite, et de s’abriter derrière l’Antiquité pour faire passer des vérités sur son époque. Une antiquité non pas patrimoniale, mais stratégique : un masque pour dire la guerre civile, le compromis, la trahison des idéaux, la tentation d’ordre, la fatigue révolutionnaire. Une machine à déplacer le présent : parler d’hier pour viser aujourd’hui, parler de la Grèce pour viser l’Italie, et par ricochet, viser l’Europe. Dès le début, le cadre est donné : le rêve sera l’endroit de la folie et de la fureur, son refuge. Le rêve comme laboratoire, comme zone de vérité sauvage, comme chambre d’écho des violences politiques. Le rêve, donc, comme seule place encore possible pour ce qui ne rentre pas dans l’ordre.
Mais voilà : les jeunes acteurs du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique se mettent à crier, à s’engueuler, à grimacer. Surjeu. Et très vite on comprend la consigne implicite : l’émotion principale sera la colère. De bout en bout. La colère qui écrase tout. Plus la moindre nuance perceptible. Ils ne font que se rentrer dedans, comme si la tragédie se résumait à un volume sonore et à une tension musculaire. Tout est agressé. Tout est urgent. Tout est “important”. Et à force d’être joué au maximum, plus rien ne l’est. On assiste moins à une montée qu’à un plateau constant : pas de gradation, pas de respiration, pas de variations de température. La colère, au lieu d’être un outil, devient un écran, et l’on perd la variété morale du texte : l’hésitation, la honte, la peur, la lâcheté, la lucidité, le désir, la fatigue. Pasolini, qui écrit aussi les zones grises, se retrouve recouvert par une monochromie émotionnelle. Et c’est dommage, parce que Pylade est précisément un texte sur la complexité des positions, sur ce que la pureté politique ne sait pas faire, sur ce que la fidélité aux idéaux coûte.
À cela s’ajoute un principe de distribution qui finit par saboter la compréhension. On s’échange les rôles. Les Oreste et les Pylade s’enchaînent. On se passe les personnages comme des relais. Au détriment de toute continuité affective, de toute trajectoire. Un savant jeu de projection des noms des personnages au moment où ils parlent tente d’aider (comme un sous-titrage de théâtre, un prompteur pédagogique), mais le dispositif dit surtout ceci : “ne cherchez pas trop à croire, cherchez à suivre”. Comme si l’émotion devait être remplacée par une cartographie. Parfois un même rôle est joué par trois actrices. Comme s’il fallait donner à chacun un temps égal, une part égale, un droit égal à la lumière. Égalité louable en école, mais dangereuse au plateau : l’égalité de traitement produit une inégalité d’incarnation. On ne sait plus ce qui est en jeu, seulement que ça circule. Et la circulation devient un sujet en soi, au détriment de ce que le texte tente d’installer : des responsabilités, des conséquences, une histoire morale.
Et puis il y a ce détail qui tue : le texte est souvent joué avec une consigne visible, presque mécanique, exemple : des bras en l’air, sans nécessité diégétique. Geste-signe, geste-tic, geste d’exercice. Voilà bien les affres d’un travail de conservatoire : la forme comme preuve de travail, le geste comme marqueur d’effort, le corps comme déclaration. On est parfois à la limite de la bande démo. Démonstration de puissance vocale, de présence, de “capacité”. Chacun son moment. Chacun sa petite affaire privée. Chacun son explosion. Comme s’il fallait prouver qu’on existe. Comme si le plateau était un concours de vitalité. Et c’est ici que ça devient triste : le collectif, pourtant promu par le dispositif bifrontal, la troupe beige, le travail de choeur magnifique, est sans cesse fissuré par la logique individuelle de l’exercice. On voit des acteurs travailler, pas des personnages agir. On voit une école produire, pas une œuvre se construire.
Du coup, le spectacle semble produire malgré lui une thèse sur l’école. Il montre ce que c’est que travailler “en cours”, avec ses rituels, ses tics, ses démonstrations, ses “preuves” à donner. Il trace, avec une honnêteté brutale, une frontière entre un laboratoire (où l’on cherche, où l’on essaye, où l’on échoue) et un projet professionnel (où l’on choisit, où l’on coupe, où l’on assume une ligne). Et c’est peut-être ce que Creuzevault veut défendre : le droit au temps, aux ratés, à l’exploration, à la répétition comme matière. Un manifeste pour donner des moyens aux artistes. Mais le paradoxe, c’est que ce manifeste, présenté au public, devient un objet exposé : une démonstration de recherche, plus qu’une recherche transformée en théâtre. On assiste à une revendication de processus, mais on en paie le prix : le spectacle ressemble parfois au procès-verbal de son propre chantier. Peut-être pour cela qu’il fallait sous-titrer étude pasolinienne : comme un aveu. Comme une protection. Comme un “ne jugez pas trop, c’est une étude”. Comme un rapport de classe.
Surtout, il y a la question politique : le détour opéré par Pasolini pour parler de la révolution. Le texte n’est pas simple si l’on ne connaît pas le mythe des Atrides et c’est souvent le cas aujourd’hui. Tant mieux, au fond : réviser ses classiques ne fait jamais de mal, et le théâtre sert aussi à rouvrir des généalogies. Mais Pasolini milite ici pour une révolution prolétarienne, dans un moment historique précis. On est en 1966. Avant 1968. Avant #MeToo. Avant la conscience climatique telle qu’elle structure désormais l’horizon politique. La révolution que Pasolini pouvait rêver, appeler de ses vœux, ne se formulerait pas aujourd’hui de la même manière. Or la mise en scène ne prend pas vraiment ce problème à bras-le-corps. Elle exhibe la colère, elle exhibe le collectif, elle exhibe l’énergie, mais elle n’actualise pas le nœud : que veut dire “révolution” en 2026, avec l’écologie, le féminisme, les migrations, les nouvelles formes de domination et de travail ? Est-ce qu’une révolution communiste, donc potentiellement productiviste, est encore pensable sans se contredire ? Est-ce que le monde ne réclame pas plutôt une révolution écologique et féministe, c’est-à-dire une révolution du soin, des corps, des ressources, des rapports de pouvoir ? Il y a bien un chaste bisou sur la bouche entre Pylade et Oreste, mais il ressemble moins à un geste politique qu’à une caution queer un peu timide, un signe “au passage”, qui rate le coche : ça ne déplace pas le texte, ça le maquille. Et c’est précisément ce qui rend le texte “daté” : non pas son âge, mais l’absence de friction avec notre présent.
Et pourtant, malgré tous ces défauts, le spectacle reste joyeux. Fou. Vivant. Il y a des éclats, des fulgurances, des présences. On sent des pépites. On sent des corps qui cherchent, des voix qui veulent, des acteurs qui brûlent de sortir de l’école. Il y a quelque chose de contagieux dans cette énergie brute, même quand elle déborde, même quand elle confond force et justesse.
Reste une question, la plus gênante : quand une “étude” devient un spectacle, qui est vraiment mis en scène ? Pasolini ? Ou l’institution elle-même, exhibant sa fabrique, ses tics, ses rites, sa façon d’enseigner la colère comme si c’était le premier outil du métier.


