
Welfare
Julie Deliquet
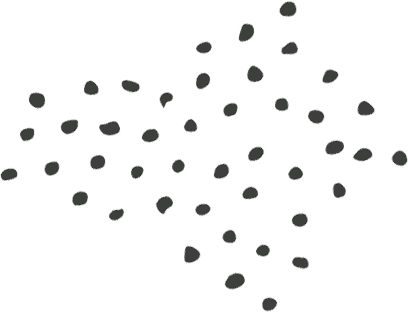
Sans caméra, la misère joue-t-elle pareil ?
Adapter un documentaire, quelle drôle d’idée. Et pourquoi pas ? Le théâtre documentaire, c’est un peu la marotte du moment. Il se pourrait que ça permette d’éviter l’écueil de la narration, et le réel, c’est toujours une source de légitimité commode. Mais combien de metteurs en scène s’embourbent dans des recherches pour lesquelles ils n’ont pas été formés ? Ils ne sont pas sociologues après tout. Et puis il y a une violence particulière à dramatiser le vécu, à faire “récit” de la détresse des autres, à transformer une file d’attente en intrigue, une humiliation en scène “forte”. Alors oui : autant s’emparer d’un film, d’une matière déjà cadrée, déjà montée, et se consacrer à son transfert sur un plateau. Là, c’est justement le travail d’un metteur en scène. Et Julie Deliquet, elle, sait faire : elle sait fabriquer du collectif, du frottement, de l’écoute en action, sans psychologiser à outrance et sans plaquer une morale.
Elle entreprend donc de rejouer Welfare, ce documentaire sur l’aide sociale aux États-Unis, et elle le rejoue dans une salle de théâtre qu’elle transforme en vieux gymnase défraîchi. Car demander de l’aide, c’est du sport. Voilà qui est bien vu. Ce décor n’est pas un “concept”, c’est une évidence physique : lignes au sol, néons fatigués, bancs, circulation contrainte. On vient ici pour “être pris en charge” et l’on se retrouve à devoir tenir debout, patienter, prouver, se raconter, se répéter. On est évalué. On s’épuise. L’adaptation a cette intelligence-là : elle ne cherche pas l’illustration, elle trouve la métaphore concrète.
Et le sujet, finalement, n’est pas seulement américain. Il permet de se demander si le traitement de la pauvreté a changé, si nous ne sommes pas, aujourd’hui, dans une situation étrangement sœur de ces années 70, avant Reagan. Tout sonne contemporain : même injustice, même inhumanité bureaucratique, même logique comptable qui mord sur l’humain. Surtout cette absurdité, cette perte de sens : des employés des services sociaux impuissants, empêchés, incapables de faire leur travail parce que les moyens ne suivent pas, parce qu’on balade les gens de bureau en bureau, parce que l’administration se protège en se défaussant. Deliquet excelle à rendre cela palpable : l’empilement des micro-conflits, les malentendus, les nerfs à vif, la fatigue qui transforme une demande en affrontement.
Mais il y a un angle mort, et il n’est pas anodin : à force de “rejouer” le documentaire comme si la scène pouvait absorber l’image sans reste, Julie Deliquet semble parfois oublier la présence de la caméra. Or, la caméra n’est pas neutre. Elle change les comportements, elle modifie les réactions, elle fabrique déjà une situation. Dans le film, certains s’exposent parce qu’ils sont filmés, d’autres se retiennent parce qu’ils le sont, et même l’administration joue autrement dès qu’un œil enregistre. Sur un plateau, cette médiation disparaît, et avec elle une couche de réel : la conscience d’être vu, archivé, capturé. Le théâtre gagne alors en frontalité, mais il perd parfois une complexité : ce qui, au cinéma, est aussi une scène du regard (qui filme qui ? qui profite de quoi ?) devient plus directement une scène de la détresse. Ce n’est pas une faute, mais c’est un déplacement qui mériterait d’être assumé, travaillé, rendu sensible.
Ça crie et c’est parfois insoutenable. Mais c’est précisément l’intérêt, et la limite aussi : à force de tenir le spectateur dans cette tension continue, on frôle parfois l’épuisement plus que la pensée. Il manque par instants une respiration, un vide, un trou dans le tumulte pour que l’horreur administrative se mette à résonner autrement que comme un constat.
Et surtout il y a cet homme qui accuse les Noirs d’être la cause de sa misère, qui se promet de les tuer. Et c’est à ce moment-là que la pièce vrille. Elle a pris un coup de vieux en moins d’un an. Non pas parce qu’elle serait datée, mais parce que le réel a accéléré. Répétée avant l’élection de Trump, avant l’évidence de certains basculements, elle revient aujourd’hui comme une prophétie froide : on voit ce que produit un système qui ne répond pas aux besoins des pauvres et des exclus. Il alimente le désespoir et la violence, il organise le racisme en offrant des boucs émissaires à la rage. Glaçant. Et, malgré quelques longueurs et le risque de la reconstitution, c’est là que l’adaptation devient théâtre : non pas une archive rejouée, mais un miroir qui fait mal, tenu avec une rigueur collective impressionnante.


