
Cette autre chose
Bruno Meyssat
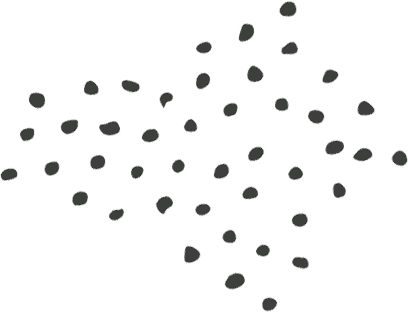
Brocante métaphysique
Les spectacles de Bruno Meyssat sont d’un autre âge. Non pas qu’ils soient dépassés. Mais on n’en voit plus des comme ça, ou si peu, et c’est précisément pour cela qu’ils frappent : ils réactivent une idée presque oubliée du théâtre, celle d’un art qui n’a pas besoin de s’expliquer, ni de se justifier, ni de se vendre par avance. Bien souvent aujourd’hui, ce que l’on voit s’apparente à une performance, non pas au sens artistique mais au sens physique, presque sportif, spectaculaire si l’on veut (effet wow) : exploit d’un corps, démonstration d’endurance, prouesse de présence, mais presque sans tête, sans pensée, sans prise. C’est beau, c’est grand, c’est fort, mais ça ne dit rien, ou plutôt ça dit : “regardez-moi”. Il y a aussi les spectacles qui parlent, ceux qui racontent, bavards à outrance, saturés de texte, et c’est bien souvent « la petite affaire privée » qu’on entend à travers « la parole sale » comme dirait Deleuze : confession, opinion, morale de fin de scène, psychologie au forceps. Avec Meyssat, rien de tout ça. La narration : liquidée. Le commentaire : annulé. Le “message” : laissé à la porte.
Et les acteurs : des figurants. Ils ne sont pas là pour “incarner”, encore moins pour “s’exprimer”. Ils sont là pour déplacer des objets, les déplacer vraiment, les agencer, les exposer, les mettre en crise. Et faire du troc parfois. Et c’est bien connu, les objets sont des acteurs justes. Quoiqu’ils fassent, ils jouent leur rôle à la perfection. Une chaise interprète la partition de la chaise parfaitement, sans même suivre d’hypothétiques indications d’un metteur en scène, de toutes les façons inutile : elle est chaise, et cela suffit à faire événement. Un porte-bouteilles ne “joue” pas, il persiste. Une tondeuse n’a pas besoin d’intentions pour inquiéter. Un tapis n’a pas besoin d’affects pour imposer son cérémonial. Cette autre chose organise ainsi un renversement délicieux et terrible : ce sont les choses qui tiennent le plateau, et les humains qui deviennent la main d’œuvre de leur apparition. C’est presque un spectacle à la Tati, loufoque mais sans le vouloir, comme par inadvertance : une comédie des usages, des ratés, des maladresses, des obstinations. Décalé, en tout cas, où ce sont les objets qui jouent, et où les acteurs ne sont ici que des faire-valoirs, des passeurs, des porteurs, des opérateurs d’un monde matériel qui les dépasse.
Alors il y a tout de même des points d’accroche pour garder l’œuvre ouverte, et faire des spectateurs des producteurs de sens, pas seulement des consommateurs repus. On verra peut-être dans les décors le monolithe noir cher à Kubrick, et qui serait finalement ce qui nous aura rendus humains : cet objet métaphysique aux formes antinaturelles dont la rencontre nous mène à l’invention de l’outil, à ce geste qui nous arrache à la nature en nous y re-clouant autrement. Il y a aussi le porte-bouteilles hérisson de Duchamp, le premier ready-made : objet manufacturé commun, trouvable au BHV, et pourtant élevé au rang d’œuvre d’art par un simple déplacement. Et c’est peut-être là que le sens se noue : dans la question du marché, du marché de l’art, et de la place des objets dans ce fatras. Car il s’agit d’objets usés, de seconde main, de troisième vie : on pourrait les chiner en brocante, oui, mais on les trouverait tout autant dans un vide-maison ou une décharge. La question du réemploi, la question du recyclage, la question de la valeur perdue et qui pourtant est encore là, obstinée, incrustée, presque mystique. Tout cela au son de bruits de boîtes à musique, comme un souvenir d’enfance mal rangé, mais aussi du piano arrangé de John Cage, qui fait entendre la musique comme un accident contrôlé, une mécanique trouée. Et on se met à penser à Kantor, à Josef Nadj plus près de nous, mais aussi à Matthew Barney : même profondeur, même convocation du mythe, même façon de faire surgir des rites sans les nommer. Le même rapport au marché de l’art, toujours. Car ces objets, ce sont aussi les marchandises fétiches de Marx : ces choses qui nous regardent, qui nous capturent, qui s’ornent d’une aura, comme si leur valeur venait d’ailleurs que de nos mains.
Ce théâtre nous dit ce que nous vivons : un monde envahi par les objets, où nous ne sommes plus que des esclaves, sommés d’accomplir les gestes correspondant à leur affordance, la sainte déité. Les choses nous prescrivent. Elles commandent nos postures, nos rythmes, nos désirs, nos peurs. Nous sommes des objets. Et c’est à nous, à mesure que nous vieillissons, que la question de notre propre valeur se pose : valeur d’usage, valeur d’échange, valeur résiduelle. Avant la mise en boîte, un éventuel recyclage, ou bien sommes-nous condamnés à l’obsolescence ? Meyssat lutte contre ça, sans sermon et sans plainte : en donnant aux choses une scène, il nous rend à nous-mêmes. En montrant l’usure, il fait apparaître une dignité. En organisant ce manège d’objets et d’humains, il fabrique une forme de liturgie sèche, drôle, inquiétante, et profondément vivante. Et c’est sans doute là que son théâtre, d’un autre âge, redevient soudain d’aujourd’hui : non pas parce qu’il colle à l’époque, mais parce qu’il la met à nu.


