
Les corps incorruptibles
Aurélia Lüscher
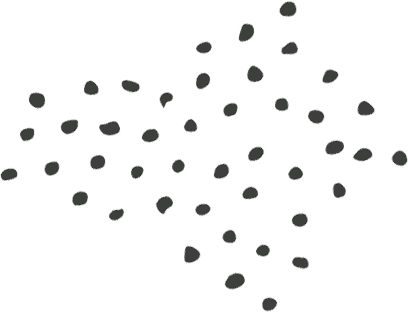
enterrer propre, aimer mieux
On l’avait adorée dans Vaisseau familles du Collectif Marthe ; on la retrouve ici seule, plus libre, plus joueuse, avec Les corps incorruptibles. Aurélia Lüscher ne s’adonne pas seulement au théâtre documentaire : elle ourdit une enquête sensible, intime et politique mais elle refuse les deux pièges du genre. 1er écueil : être bavard, pédant et déconnecté (la conférence théâtralisée). 2ème écueil : échappant à la narration, les acteurs en arrive à ne plus jouer, juste à dire, à proférer. Au risque d’ennuyer là encore. Et puis, un documentaire réclame un bon sujet. Ici on traitera de la mort, comment on l’appréhende. À première vue on pourrait craindre le pire. Ce n’est pas le sujet le plus joyeux. Le plateau s’ouvre sur une morgue de papier, carreaux tracés au pinceau, blancheur clinique, puis dérive, presque insensiblement, vers l’atelier : l’espace s’aère, la rigueur hospitalière s’effrite, la matière appelle la main. C’est là sa trouvaille : déplacer la mort du côté du faire, de l’artisanat, du soin.
Lüscher raconte en contrepoint, avec facétie à coup d’anecdotes familiales (sa grand-mère à la santé fragile qu’elle préfèrerait voir décéder à la maison, comme 70% des Français, plutôt qu’à l’hôpital, où meurent 70% des mêmes Français, à qui elle lance « je t’aime fort, tu peux y aller, tu peux mourir »), de messages vocaux de sa mère qui refuse de participer au spectacle mais est d’accord pour appeler les Pompes funèbres pour se renseigner, d’interventions canines bien vivantes et joyeuses. Elle traite le sujet sans jamais sombrer dans le pathos, bien au contraire : en nous faisant rire de bon coeur.. Se faisant, la performeuse malaxe, dresse, rassemble l’argile, recompose un corps comme on refait une histoire. Frankenstein modeste, golem de glaise, liturgie profane : la pièce substitue au fantasme de l’incorruptible le savoir de la décomposition, le retour au cycle.
Car l’enjeu n’est pas de contempler la grande faucheuse, mais de la conjurer en examinant scrupuleusement l’industrie qui s’est interposée entre nos morts et la terre. Produits de conservation, bois traités, caveaux bétonnés : tout un appareillage pour suspendre le vivant et maquiller l’inévitable. Lüscher déplie ces logiques sans dogmatisme, par petites touches, et relie les champs : écologie des rituels, économie du deuil, gouvernement des corps. Sa perspective, résolument féministe, s’adosse à une pensée anticapitaliste limpide : il n’y aura pas de transition, a fortiori écologique, sans dépatriarcaliser nos rapports au soin, au temps, aux héritages. Elle convoque Val Plumwood (qui manque d’être dévorée par un crocodile) pour infléchir notre regard : accepter de réintégrer la chaîne alimentaire, cesser de concevoir la terre comme exil, la reconnaître pour ce qu’elle est : un foyer.
Et puis il y a le fameux retournement — je n’en dirai rien, sinon qu’il recompose l’ensemble comme une dernière pièce ajoutée au puzzle. Au-delà d’être une pièce sur la mort, il s’agit sans doute d’une pièce sur l’amour, l’amour que l’on porte aux vivants. On comprend alors que le spectacle, sous son apparente modestie, avance avec une précision chirurgicale. Rien d’ostentatoire, aucun fétichisme du choc : une patience, une gaîté têtue, une intelligence du plateau qui pratique la soustraction plutôt que l’emphase. Les corps incorruptibles n’exhibe pas la mort ; il réhabilite les vivants dans leur capacité à en parler, à en rire, à en décider. On en sort étrangement ragaillardi : plus lucide, moins docile. C’est rare. C’est précieux. Et c’est pleinement réussi.


