
TO LIFE
Suzanne
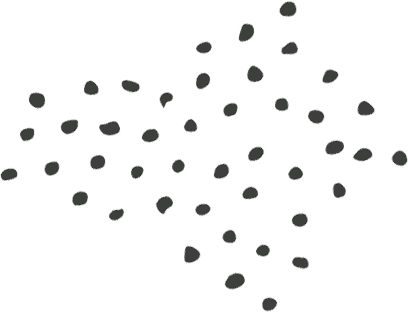
À la vie, malgré tout
Il fallait bien que le monde s’effondre pour que surgisse, du fracas des ruines, une procession d’êtres obstinés. TO LIFE de SUZANNE est cette traversée lente d’un territoire en miettes, ce cortège épuisé mais debout, qui avance contre tout, contre rien, vers un horizon que l’on sait désormais désert. La marche, cet acte primitif, devient ici le dernier geste de résistance — une tentative in extremis d’exister encore.
La scène est plongée dans la pénombre, fendue parfois d’éclats violents, comme des éclairs déchirant l’épaisseur du ciel avant l’orage. La lumière travaille la matière même du plateau : contre-jours acérés, ombres lourdes, flashs fulgurants. Rien n’est stable. Tout vibre d’une menace sourde, et chaque silhouette, taillée dans la nuit, semble avancer dans un monde qui n’est plus qu’un vestige de lui-même.
Dans cette atmosphère d’après la fin, les corps s’avancent lentement, comme on suit un cercueil sous un soleil implacable, ou comme l’on s’arrache au sommeil pour franchir un seuil invisible. Ils marchent, dos au vent, contre vents et marées, faces exposées, fronts butés, gravant chaque pas comme un acte d’obstination muette. À l’appel silencieux d’une Eurydice imaginaire, certains se retournent — mais rien n’est à sauver.
Leurs costumes, sombres, d’un gothisme bon marché et un brin désuet, évoquent des figures échappées d’un carnaval éteint. Pas de clinquant ici, mais une mélancolie textile : tissus noirs, coupes sans éclat, silhouettes qui préfèrent au triomphe la gravité d’une fête finie avant d’avoir commencé. À la parade exubérante succède la procession contrite.
La musique, elle, s’abat sur nous comme une onde de choc. Saturée, pulsative, presque assourdissante, elle nous enveloppe, nous écrase, nous hypnotise jusqu’à l’assoupissement. Noisy, abrasive, elle pulse dans les chairs jusqu’à les rendre cotonneuses, abolissant le temps comme un long râle sans fin. Peu à peu, l’oreille abdique, la conscience vacille : et c’est bien de transe qu’il s’agit ici, d’une transe archaïque et minimale.
Le geste fondateur de To Life — marcher — résonne bien sûr avec le célèbre « my walking is my dancing » d’Anne Teresa de Keersmaeker, dont SUZANNE semble reprendre la quête des combinatoires infinies. Pourtant, là où Keersmaeker insuffle toujours cette connivence malicieuse, ce clin d’œil complice entre les danseurs, ici règne une gravité sourde, une austérité presque glaçante. L’absence de ces éclats de malice laisse la scène sombrer dans une gravité monotone, une beauté froide, implacable.
Le concept pourrait sembler simple, presque naïf : marcher ensemble pour résister. Mais l’exécution, elle, est d’une redoutable complexité. À force de variations de rythmes, de trajectoires, d’infimes décalages, To Life expose la virtuosité silencieuse du collectif. Ce parti pris du risque, d’oser l’imperfection visible, les désynchronisations fugaces, les maladresses humaines, est profondément courageux. Car ici, le ballet n’est pas fait pour étourdir par sa perfection ; il est fait pour rappeler que même dans la marche la plus rigoureusement orchestrée, l’humain, fragile, affleure.
Par instants, une inquiétante martialité surgit. La précision des pas, leur puissance contenue, évoque la rigueur militaire, la procession totalitaire. Dans ces moments sombres, sans éclat, sans couleur ni joie, l’on pourrait croire que To Life s’abîme dans une célébration de l’uniformité, de la soumission. Mais toujours, au dernier moment, quelque chose dévie. Une démarche hésitante, une lenteur inattendue, un retour au pas initial — celui, fragile et obstiné, du début. Ainsi, jamais To Life ne bascule totalement du côté de l’oppression ; toujours, la fissure demeure, la résistance affleure.
Et pourtant, dans cette lutte acharnée contre le chaos, il n’y a guère d’espoir à saisir. Ils marchent. Ils marchent toujours. Ils marchent sans savoir pourquoi. Comme si le but n’était pas d’atteindre un lieu, mais de se dissoudre dans l’acte même de marcher. Le point de départ demeure, comme une basse continue : ce pas lourd, ancré, jamais véritablement quitté. Si la chorégraphie semble se complexifier — accélérations, croisements, solos lancés de jardin à cour — elle ne trace jamais une direction véritable. Elle fait du surplace, elle recommence, inlassablement, comme un métronome devenu fou.
On pense aux marches stupides des Monty Python. On songe surtout au Tragédie d’Olivier Dubois, dont SUZANNE a partagé l’expérience du remontage, et dont le spectre traverse le plateau : dispositif frontal devenu latéral, minimalisme sonore et corporel, répétition jusqu’à l’épuisement. Mais là où Dubois exalte la diversité triomphante des corps, TO LIFE creuse une austérité résolue. Ici, la revendication queer n’a pas la flamboyance d’une célébration ; elle se fait murmure grave, posture modeste, presque nostalgique, d’un minimalisme des années 90, délavé par le temps.
Peut-être marchent-ils pour se retrouver. Peut-être pour témoigner, simplement, de leur passage. De la fatigue émerge parfois une fulgurance : un chant solitaire s’élève, fragile, rejoint par d’autres, tissant l’espace d’une trame sonore tremblante. On croit toucher la fin. Mais il faut encore marcher.
Encore une marche : celle de l’entraide, lorsque l’un d’entre eux porte l’autre, le soutient, le soulève. Un geste de soin, fugitif, qui fend l’épaisseur de la nuit. On croit que tout est terminé — et pourtant non. Car la scène se vide, le plateau se rase, comme lavé par cette traversée inlassable.
Et alors, surgit une silhouette inattendue : une femme âgée, vêtue d’un jean bleu et d’un pull rouge, seule coquetterie permise dans cette apocalypse feutrée. Dernière figure du monde d’avant, ultime drag queen fatiguée d’un carnaval disparu. Boomeuse perdue, hébétée, elle arpente l’espace désert, comme surprise d’y être seule. Son apparition est poignante, énigmatique : elle est peut-être la survivante d’une époque révolue, le témoin de ce qu’il reste quand tout a été traversé.
À quoi aura donc servi cette marche infinie ? Peut-être à cela seulement : à faire advenir ce silence. Ce plateau nu, ce souffle suspendu. Ce vertige du rien qui, contre toute attente, affirme encore la vie.
Thomas Adam-Garnung


