
Les Sentinelles
Bénédicte Cerutti
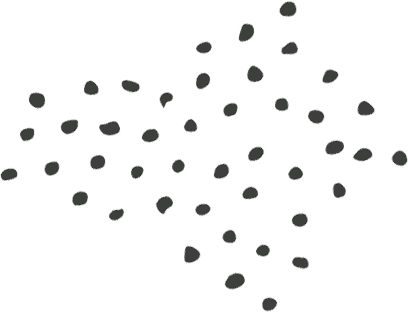
la parole des ombres
Il est rare qu’un auteur sache incarner ses propres mots avec une telle acuité. Trop souvent, le verbe écrit s’enlise dans le silence de la page, inapte à renaître au plateau. Bénédicte Cerutti, elle, fait l’inverse. Elle s’empare de sa propre langue, de ses blessures peut-être, et les transforme en matière vivante. Elle ne joue pas : elle donne naissance. Son verbe est un souffle, un sang, une chair qui palpite. C’est un accouchement sans cris, sans pathos — mais chargé, à chaque inflexion, d’une intensité brûlante.
Dès les premiers instants, une gravité sourd. L’évocation de l’enfance fait craindre le gouffre, le trauma tapi sous les mots. Pourtant, c’est le rire qui surgit. Un rire étrange, flottant, comme dans un rêve un peu fiévreux. Car le spectacle adopte la logique onirique : celle des glissements absurdes, des images mouvantes, des associations libres. Tout y est connotation, évocation, déplacement. Le monde se renverse doucement sous nos pieds.
Le texte, ciselé à l’extrême, éclate de jubilation dans sa folie douce. Il avance par fragments, éclats, courts-circuits poétiques. On pense à Lacan, bien sûr, tant le signifiant y règne en maître, insaisissable, flottant. On songe aussi à Ulysse, à cette errance polyphonique où le sens déborde, où le langage devient une matière sonore, presque physique. Rien ne s’explique, tout s’éprouve.
Chercher un sens stable serait trahir ce théâtre-là. Les Sentinelles ne s’analyse pas — elle se traverse, comme un territoire inconnu. On s’y avance à tâtons, à la manière d’un anthropologue débarquant sur les rivages des îles Sentinelles : ces terres closes, ces peuples muets dont nous ne savons rien, et qui, peut-être, se sont déjà tus à jamais. Le spectacle nous place face à cette énigme : l’autre, radical, opaque, et ce désir désarmé que nous avons de l’atteindre, de lui dire je t’aime, alors que la langue trébuche, que la main hésite.
Dans cette faille, entre deux voiles, l’image surgit. La lumière de Kelig Lebars cisèle le plateau comme on grave une mémoire instable. Et surtout, Marine Dillard, présente en scène, peint, efface, recompose. Avec une simple éponge, elle fait apparaître des silhouettes fantomatiques, des ombres qui aussitôt s’effacent. C’est d’une beauté saisissante, fugace et périlleuse avec leurs arcs. Une mémoire qui refuse de se fixer. Une présence qui s’efface en naissant.
Et puis, il y a elle. Bénédicte Cerutti. Présence rare, sidérante de justesse. Elle n’interprète pas : elle traverse, elle incarne, elle écoute. Sa voix, d’une douceur troublante, trace un sillon dans le silence. Elle n’a pas besoin de hausser le ton : sa parole vibre, s’infiltre, bouleverse. Elle laisse sur le plateau une empreinte discrète et profonde, indélébile. Peut-être la plus grande actrice de sa génération. En tout cas, la plus singulière.
Les Sentinelles est un poème scénique, un vertige de mots et de silences, un geste rare. On n’en sort pas indemne, mais un peu plus sensible au mystère de vivre. C’est salutaire.


